Crédit photo : hotpot.ai/art-generator & ladentbleue.fr
Ecouter l’épisode
Bonjour. C’est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast “La Dent Bleue, l’histoire des vikings”. Épisode 13 : “Yamnaya Gang : les caïds des steppes”. Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l’histoire des vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l’ordre, à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesses et de prestige.
Cet épisode est le cinquième et dernier d’une série sur les Proto-Indo-Européens que l’on a identifié aux Yamnayas, un peuple qui a été à l’origine de nombreux traits culturels de la société scandinave de la période viking. Et plus généralement, à l’origine de nombreux traits culturels encore existants dans nos sociétés modernes. Les Yamnayas dont nous allons décrire le mode de vie dans cet épisode sont les ancêtres majoritaires des Scandinaves de la période viking. Ce sont pour ces raisons que nous nous attardons particulièrement sur cette population dans le podcast.
Hiérarchie, structure sociale, chefs & rois chez les Proto-Indo-Européens
Dans l’épisode précédent, nous avons découvert comment la linguistique permettait de révéler les relations familiales chez les Proto-Indo-Européens. Mais cela ne s’arrête pas là, la linguistique nous apprend aussi des choses sur la société Yamnaya allant au-delà du cercle familial. Le déms potis est le chef de famille, mais au-dessus de lui se trouve le weikpotis, le chef de tribu, qui détient du pouvoir sur un groupe. Il existe également une autre fonction de pouvoir, le reg. La racine reg donnera rex dans les langues italiques et donc roi en français ; elle donnera rix en celte, comme dans Vercingétorix ; reich en allemand ; ou encore raj en sanscrit qui donnera le nom rajan signifiant roi. Mais à l’origine, en proto-indo-européen, la racine reg désignerait plutôt un prêtre ou un régulateur : quelqu’un qui définit des frontières correctes et fait les choses correctement. En anglais, someone who makes things right – encore un dérivé de reg. (Anthony, 2007, p. 190)
Les Proto-Indo-Européens avaient donc institutionalisé les rôles de pouvoir. L’archéologie nous a montré que les Yamnayas ne sont pas les premières populations des steppes à avoir des relations de pouvoir institutionalisées, avec des chefs détenant beaucoup plus de richesses que le reste de la population. Dès -5 200, avec la généralisation de l’élevage dans les steppes par la culture Dniepr-Donets, ces différences exacerbées ont commencées à apparaître dans les tombes. Nous en avons parlé dans l’épisode 9 : des chefs étaient enterrés de façon ostentatoire avec de nombreuses richesses, des pendentifs, des ceintures, des bracelets, des armes… et de nombreux sacrifices d’animaux. Rien de tout cela n’existait dans les steppes à l’époque des groupes de chasseurs-cueilleurs. (Anthony, 2007, p. 190)
Certaines personnes détenaient donc des positions puissantes dans la société. Les autres devaient les respecter et se placer en-dessous de ses élites. En échange, les chefs de tribus et les rois organisaient et parrainaient des banquets où ils distribuaient nourritures et cadeaux. (Anthony, 2007, p. 190) Les partenariats étaient probablement scellés par des échanges de cadeaux. Dans la langue proto-indo-anatolienne, qui est antérieure à l’apparition de la langue proto-indo-européenne, les mots « donner » et « recevoir » ont des racines très proches. Cela démontre un lien très fort entre ces deux actions et les spécialistes pensent que ces cadeaux allaient en général dans les deux sens. On donne et on reçoit. (Anthony, 2007, p. 238)
Il en va de même avec le mot « hôte ». En français, le mot « hôte » peut avoir deux sens : le sens privilégié est celui de la personne qui accueille, mais l’hôte désigne également celui qui est accueilli. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi utiliser le même mot pour deux rôles qui semblent pourtant opposés ? En anglais, on a deux termes, on trouve le « host » qui accueille et le « guest » qui est accueilli. Certes, mais ces deux termes ont la même racine. Pourquoi ? On estime que chez les Proto-Indo-Européens, l’hospitalité fonctionne dans les deux sens : on est accueilli par quelqu’un, mais plus tard, les rôles s’inverseront et l’hôte deviendra l’hôte de son ancien hôte (prononcer rapidement). Vous voyez l’idée, quoi. Lorsqu’un membre d’une famille est accueilli par une autre famille, un lien d’obligation mais aussi d’amitié se crée non seulement entre les deux hôtes, mais également entre les deux familles. On retrouve cet exemple d’obligation et d’amitié dans l’Illiade d’Homère. Alors que Glaukos et Diomède sont sur le point de s’affronter, ils échangent leurs généalogies et découvrent que leurs grands-pères ont jadis entretenu une relation d’hospitalité. Ils décident alors de ne pas se battre, échangent leurs armes en signe d’amitié et scellent ainsi le respect de cette ancienne alliance.(Anthony, 2007, p. 302)
Chez les Yamnayas, ce système d’obligation mutuel crée des liens entre les différents familles et tribus. Celles-ci développent alors des réseaux étendus d’hospitalité. Des réseaux bien utile lorsque l’on vit de façon nomade en faisant bouger ses troupeaux de pâturages en pâturages. Si l’on est ami avec un clan, on peut solliciter de traverser son territoire et bénéficier d’un laisser-passer. Les autres cependant, ceux qui n’ont pas tissé de relation d’hospitalité avec les maîtres du territoire, n’y sont peut-être pas les bienvenus. (Anthony, 2007, p. 302) Le vocabulaire proto-indo-européen montre une claire distinction entre « mon groupe » et « les autres ». Tout ce qui est lié au clan est sûr et précieux alors que l’extérieur est… Eh bien, d’un côté il est hypocrite, dangereux et hostile, mais de l’autre il est également une source potentielle d’enrichissement et d’alliances utiles. (Olsen et al., 2019, p. 158‑159) L’horizon Yamnaya s’est construit par son mode de vie : le pastoralisme nomade. Pour s’adapter à ce mode de vie, on pense que la société Yamnaya a créé cette institution de l’hospitalité réciproque, qui a pu jouer un rôle crucial dans la diffusion de cette culture dans toute la steppe pontique. (Anthony, 2007, p. 302)
Apparu dans un coin à l’ouest de la steppe pontique, l’horizon Yamnaya s’est rapidement diffusé dans toute cette steppe. Et a priori, ce n’est pas nécessairement par la guerre qu’ils ont dominé la steppe pontique, car il n’y en a que peu de traces, mais peut-être plutôt grâce au succès de leur modèle culturel et économique. Grâce aux alliances forgées par l’hospitalité et grâce à la grande mobilité qui leur permet d’exploiter les ressources de la steppe au maximum, certains clans deviennent très puissants économiquement. Les chefs des familles les plus riches possèdent de très gros troupeaux, ce qui leur amène un grand pouvoir économique : ils peuvent par exemple louer des animaux ou les vendre contre des biens de prestige. Ils peuvent également sacrifier des animaux ou organiser des festins qui augmentent également leur prestige. (Anthony, 2007, p. 317) À leur décès, ces chefs sont enterrés dans des tombes avec de nombreuses richesses, les objets en métal étant la panacée. Les alliés et dépendants de ces chefs se réunissent alors pour construire des kourganes au-dessus de ces tombes pour rendre hommage au défunt. (Anthony, 2007, p. 331‑334) Une famille prestigieuse devient alors une alliée très convoitée : on cherche alors à marier ses fils aux filles de ces grandes familles. Par la loi de l’offre et de la demande, le prix de la fiancée demandée par ces grandes familles devient très élevée et cela augmente la concurrence entre les autres familles… (Anthony, 2007, p. 317)
L’archéogénétique va également dans le sens de l’existence d’une classe d’élite au sein de la société Yamnaya. L’ADN d’un individu comprend les gènes de ses deux parents. Mais en isolant le chromosome Y, qui n’est transmis que par les hommes à des hommes, d’un père à son fils, on peut retracer uniquement la lignée masculine. D’un autre côté, l’ADN mitochondrial est transmis uniquement par la mère : elle le transmet à ses filles et à ses fils. En étudiant l’ADN de nombreux individus Yamnayas, on découvre que si leurs ADN mitochondriaux sont plutôt variés, leurs ADN du chromosome Y, eux, ont beaucoup moins de diversité. Les archéogénéticiens en concluent alors que quelques lignées masculines ont eu beaucoup plus de succès reproductif que les autres. (Quiles & root, 2018) Mais alors pourquoi un petit groupe masculin a tant dominé les autres ? Eh bien, on ne sait pas. La génétique nous donne les conséquences, mais pas les causes.
Alors, voici quelques pistes en vrac. Peut-être qu’une élite masculine a contrôlé l’accès aux femmes d’une manière ou d’une autre, par des demandes de prix des fiancées très élevées par exemple, empêchant ainsi certains hommes moins riches de se reproduire. Peut-être. Ou alors peut-être que c’était la polygamie : dans plusieurs sociétés indo-européennes plus tardives, on retrouve des traces de chefs qui ont plusieurs femmes. Mais a priori, il n’y a aucune trace de cela dans le lexique proto-indo-européen, et donc vraiment aucune preuve d’une éventuelle polygamie. Peut-être que certaines familles Yamnayas ont massacré tous les autres hommes des autres familles Yamnayas et des familles des autres cultures des steppes, pour ne garder que les femmes. Ce n’est pas impossible que ça se soit passé comme ça, cependant c’est impossible de l’affirmer car il n’y a pas de preuve archéologique de ce type de massacre. La violence n’était pas étrangère aux Yamnayas, mais on n’a en tout cas pas trouvé de preuves de massacres généralisés. Cela viendra peut-être dans quelques années, qui sait ?
Laissez-moi enfin vous présenter un autre scénario possible, celui de la domination socio-économique, que je trouve intéressant, mais il ne repose pas sur plus de preuves que les scénarios précédents. Certaines familles ont atteint le statut d’élites. Leur chef domine un clan composé de nombreuses familles. Elles possèdent un troupeau énorme pâturant sur un territoire immense. Ces familles ne manquent pas de nourriture et elles peuvent s’épanouir dans ce contexte. Grâce à cette nourriture à profusion, les enfants sont en meilleure santé et sont plus nombreux à atteindre l’âge adulte. Une famille riche peut donc être une famille nombreuse, avec de nombreux hommes et femmes qui atteignent l’âge adulte. Ces hommes, qui sont tous issus du même père, vont alors se marier sans difficulté. Pas de problème pour payer le prix de la fiancée : vous voulez combien de bœufs et de moutons contre votre fille monsieur ? Et puis de toute façon, toutes les autres familles souhaitent s’allier avec cette famille dominante. Les nouveaux mariés intègrent la famille paternelle. Même dans l’hypothèse ou seul le fils aîné récupère l’héritage, les cadets de familles riches partent tout de même probablement avec des avantages comparés à ceux des autres familles. Ces hommes sont donc aisés dès le début et vont eux aussi avoir de nombreux enfants, toujours dans la même lignée masculine. Et ainsi de suite. Au contraire, une famille pauvre, qui n’a que quelques bêtes dans son troupeau, va peut-être se serrer la ceinture et ne pourra pas avoir beaucoup d’enfant : que ça soit parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre ou parce qu’ils auront plus de mortalité infantile. Et pour les fils qui atteignent l’âge adulte, les ennuis continuent. Pour trouver une femme, il faut les moyens de payer le prix de la fiancée. Et la concurrence est rude en ce moment. Mais bon, on peut imaginer qu’il y a quand même des fils de familles pauvres qui réussissent quand même à se marier avec des filles de famille pauvre. Mais cela veut dire qu’après avoir payé le prix de la fiancée et s’être peut-être séparé d’animaux, il faut nourrir la nouvelle venue et les futurs enfants du couple. Et tout ça, dans une situation économique encore plus précaire…
C’est un scénario possible. Plutôt qu’une invasion militaire, on a pu avoir une domination économique d’un petit groupe d’élite qui a généré une domination reproductive sur le reste de la population. Mais comme je l’ai précisé plus tôt, ce ne sont que des suppositions car il n’y a pour l’instant pas de moyen de vérifier comment cela s’est réellement passé. Nous reviendrons en détail sur ces hypothèses dans l’épisode suivant, car nous auront plus ou moins les mêmes questions lorsque nous parlerons de la diffusion des Yamnayas en-dehors de la steppe et du remplacement génétique des fermiers néolithiques qui va suivre.
Idéologie guerrière indo-européenne : des bandes de jeunes guerriers
Il est donc possible que la diffusion des Yamnayas dans la steppe pontique soit due à une domination économique, mais même si tel a été le cas, cela ne veut pour autant pas dire une domination pacifique. Les mythes et le vocabulaire indo-européens nous laissent penser à une vision de la propriété privée que l’on pourrait résumer en « Si je te l’ai volé, c’est à moi ».
Dans une société basée sur l’élevage, il est plus facile de s’enrichir en volant son voisin que dans une société basée sur la culture de céréales. (Anthony, 2007, p. 137) Dans plusieurs langues indo-européennes anciennes, on retrouve d’ailleurs une expression signifiant « conduire le bétail », dans le sens d’une razzia de bétail. (Anthony, 2007, p. 91) On vole un troupeau et on le conduit dans son territoire, comme on peut le voir dans certains westerns.
Ces razzias de bétail sont encouragées par les croyances et rites indo-européens. Le mythe proto-indo-européen du guerrier Trito, que nous découvrirons à la fin de cet épisode, justifie carrément le vol de bétail. Pour les Indo-Européens, ce vol n’est en fait pas un vol mais juste la récupération du bétail que les dieux avaient de toute façon destiné aux gens qui font leurs sacrifices correctement. (Anthony, 2007, p. 238‑239)
Pour voler du bétail, les Yamnayas font leurs razzias en groupe. C’est l’institution du Mannerbunde, qui occupait une importance centrale dans les rites d’initiation proto-indo-européens. (Anthony, 2007, p. 364‑365) Grâce à des sources historiques de cultures indo-européennes plus tardives, on peut reconstruire cette tradition proto-indo-européenne, dont certains éléments sont corroborés par l’archéologie.
Le Mannerbunde, littéralement la « troupe d’hommes », c’est un gang de jeunes guerriers, composé des garçons entre 12 et 19 ans, guidé par un chef plus âgé. Ces gangs sont parfois aussi surnommés « La jeunesse noire ». (Kristiansen et al., 2017) Ces jeunes guerriers sont liés les uns aux autres et liés à leurs ancêtres par des serments de fidélité au cours d’un raid rituel et obligatoire. Les jeunes initiés deviennent alors une meute de loups, ou parfois de chiens. Lors du rituel, chacun reçoit un nom de loups ou de chien. Ces jeunes guerriers portent des peaux de loups sur le dos et des pendentifs de canines de chiens autour du cou. On a d’ailleurs retrouvé un grand nombre de ces pendentifs portés par les individus enterrés dans les kourganes de la steppe pontique. Les guerriers portent des ceintures : deux pour les initiés, une pour le chef. Pourquoi le chef est-il moins fourni en ceinture que les autres ? C’est parce que la ceinture, c’est le lien, la contrainte, l’obligation. Le chef ne prête qu’un seul serment, celui fait aux dieux. Tandis que les initiés prêtent à la fois serment aux dieux et au chef. La ceinture est d’ailleurs le vêtement le plus représenté sur les stèles érigées par des migrants Yamnaya en Bulgarie, ce qui montre sa dimension symbolique. (Anthony, 2007, p. 364‑365)
En termes d’organisation ou de nombre, il ne faut pas imaginer les Mannerbundes comme des armées, mais plutôt comme des gangs de bandits. (Anthony, 2007, p. 237) Ces gangs pratiquent des activités prédatrices, aux marges de la société, tels des loups. Ils chassent, ils pillent, ils volent. Mais comme les vikings 4 000 ans plus tard, ces raids sont des activités saisonnières. Le reste du temps, ces jeunes vivent avec leur famille et sont des cow-boys comme les membres de leur famille plus jeunes et ceux qui ont passé l’âge de ces folies. Car vers 20 ans, le jeune homme Yamnaya rentre dans le rang. Il arrête les raids et rejoint pleinement sa tribu en tant qu’adulte. (Kristiansen et al., 2017)
Pour ces jeunes guerriers, voler du bétail a un intérêt économique évident, cela leur permet notamment d’acquérir un capital personnel qui peut leur permettre de payer le prix d’une fiancée et donc de se marier et fonder un foyer. (Anthony, 2007, p. 238‑239)
Il semblerait que les Mannerbundes étaient essentiellement composés de cadets, mais pourquoi ? Eh bien, il est très probable que chez les Proto-Indo-Européens, l’héritage suivait la règle de primogéniture masculine, c’est-à-dire que seul le frère aîné héritait des biens et du statut du père. Cela crée pour les cadets une pression pour s’enrichir par eux-mêmes… Et rejoindre une bande de pillards semble être une bonne façon de le faire.
Parmi les causes possibles de l’expansion des Yamnayas, cette organisation guerrière et cette dynamique de recherche de richesse des cadets font partie des hypothèses les plus mises en avant. Et retenez bien cette logique, car nous reparlerons des mêmes dynamiques lorsque nous analyserons les nombreuses causes de la période viking. Ah vous voyez, je vous avais dit qu’on en apprendrait sur les vikings grâce à leurs ancêtres Yamnayas !
Ces razzias sont les conséquences de la dynamique économique en cours chez les Yamnayas. Quelques familles ont réussi à tirer leur épingle du jeu et dominent des immenses territoires. Elles rivalisent pour le prestige et affichent leurs statuts avec des tas de bijoux et marques ostentatoires de pouvoir, ce qui crée une compétition sociale. Dans ces sociétés, les mariages sont un levier de pouvoir. Rappelons-nous que chez les Proto-Indo-Européens, quand on se marie, on gagne des alliés. Si vous êtes le chef d’une famille faisant partie de l’élite, la crème de la crème Yamnaya, tous les jeunes hommes vont chercher à s’allier à vous. Mais vous, vous n’allez quand même pas marier votre fille à n’importe quel plouc. Donc vous faites monter les enchères : combien de vaches et de moutons tu proposes, toi ? Et toi ? Vous avez compris l’idée, inflation du prix des fiancées, d’abord chez les élites, puis plus globalement les prix augmentent car personne ne veut être en reste. (Anthony, 2007, p. 238‑239)
Quelle solution reste-t-il pour un jeune homme qui n’a pas trop de moyen mais qui souhaite se marier ? Heureusement, un influenceur a une solution pour tous ces jeunes désespérés qui ne savent pas comment s’y prendre : « Salut à toi jeune entrepreneur, alors si aujourd’hui je me permets de te contacter, c’est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu veux faire pitié et prendre le bus tous les jours ? Ou est-ce que tu veux commencer très rapidement à faire de l’argent avec moi, grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ? Moi je pense, la question elle est vite répondue. Alors, sois tu me suis, sois tu vas demander de l’argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. »
C’est à peu près le discours qu’a pu leur tenir un chef de gang qui voulait recruter dans sa bande des jeunes entrepreneurs pour lancer des razzias. Le téléphone et le véhicule haut de gamme en moins. Au fait, pour ceux qui n’ont pas la référence, je précise que ce n’est pas un sketch mais une vraie vidéo de promotion et je n’ai pas pu m’empêcher de vous passer cette pépite ridicule en entier !
Des richesses à quatre pattes faciles à voler, une pression sociale sur les jeunes hommes pour s’enrichir, une mythologie justifiant le vol de bétail ritualisé… Le cocktail explosif.
Rituels et sacrifices chez les Yamnayas
Parmi les rituels les plus marquants d’une société, il y a forcément celui de la fin de vie. C’est un des rares rituels Yamnaya qui peut être étudié par l’archéologie ou la paléogénétique et cela se passe dans les kourganes. On a longtemps pensé que les kourganes étaient des tombes familiales. Des monuments funéraires comportant plusieurs tombes qui fonctionneraient à l’image des caveaux familiaux dans les cimetières. Des collines visibles de loin dans la steppe pour rappeler à tous à quelle famille appartient ce territoire et qui était l’illustre ancêtre qui y est enterré. Mais la paléogénétique a montré que les personnes enterrées dans un même kourgane ne sont en général pas de la même famille. (Lazaridis et al., 2025) Le mystère demeure toujours pour comprendre ce qui motivait la répartition des tombes à l’intérieur des kourganes.
Ce que l’on peut savoir cependant, c’est comment les personnes étaient enterrées. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’était en grande pompe. Les défunts étaient accompagnés d’objets précieux, de chariots, mais aussi de nombreux animaux sacrifiés : moutons, bovins, chevaux. (Anthony, 2007, p. 304) Lors des sacrifices, quelques os et parfois des crânes attachés à la fourrure étaient laissés dans la tombe, tandis que la chair des animaux était distribuée et consommée par les participants. (Lazaridis et al., 2025, p. 160) Probablement pour honorer le mort. Il y avait peut-être aussi, et c’est une suggestion personnelle, l’idée de remercier toutes les personnes qui ont participées à construire le kourgane. Mais ce qui est très probable, c’est que ces sacrifices ostentatoires étaient motivés par l’idée pour le nouveau chef de montrer à tous les clients de son père défunt qui est le nouveau boss et à quel point il est tellement riche qu’il peut sacrifier des objets précieux et de nombreux animaux pour honorer la mémoire de l’homme à qui ils ont prêté allégeance. Et ainsi espérer conserver les clients de son père. Car dans les sociétés claniques, contrairement aux monarchies bien établies, l’allégeance n’était pas héritée automatiquement de père en fils. L’allégeance était en général personnelle, d’individu à individu. La mort d’un chef était une période trouble où le fils devait négocier avec ceux qui avait prêté serment à son père. Des sacrifices ostentatoires permettent de montrer à tous qui est le nouveau patron et le digne successeur du chef. Ce fonctionnement pourrait avoir survécu dans plusieurs sociétés indo-européennes plus tardives, comme dans les tribus germaniques ou dans les chefferies vikings.
Ces sacrifices avaient peut-être lieu dans d’autres contextes que celui des enterrements. D’après le vocabulaire indo-européen, les Proto-Indo-Européens sacrifiaient également pour leurs dieux, en espérant gagner les faveurs de ceux-ci. (Anthony, 2007, p. 98‑99) Gagner les faveurs des dieux, car oui, cela va dans les deux sens. La réciprocité est une notion essentielle chez les Proto-Indo-Européens. Comme nous l’avions vu pour l’hébergement : on accueille quelqu’un et on sera plus tard accueilli. Il en va de même pour les sacrifices auprès des dieux. On donne pour recevoir. (Anthony, 2007, p. 342) Voici ce que l’on peut lire dans le Rig Veda, texte sacré sanskrit, dont je cite une traduction :
« Que ce coursier nous apporte des richesses tout‑soutenues,
du bétail en bon nombre, de bons chevaux,
des enfants mâles et des biens féconds ;
qu’Aditi nous accorde la délivrance du péché,
et que, par nos offrandes, le cheval nous assure la souveraineté. »
Vous aurez noté l’importance d’avoir des enfants mâles, ce qui correspond bien à la société patriarcale décrite. Mais surtout, on sacrifie un très bon cheval contre la promesse, ou en tout cas le souhait, de tout un tas de choses. Cette notion de contrat est primordiale pour les Indo-Européens. On la retrouve dans la société scandinave de la période viking et dans la mythologie nordique, personnifiée par les dieux Ullr ou Týr.
Ce système de sacrifice en échange de services entre les humains et les dieux se calque également à un niveau inférieur entre les clients et leur chef. Les clients promettent leur loyauté et donnent ou sacrifient une partie de leur troupeau à leur chef. En échange, leur chef leur promet sa protection et également la prospérité grâce à ses propres deals avec les dieux. (Anthony, 2007, p. 99 et 342)
Tripartition indo-européenne et mythes originaux : la mythologie comparée
Des chefs rituels… des guerriers… et des éleveurs. Y aurait-il une hiérarchie entre ces trois catégories ? C’est la fameuse théorie de la tripartition dans les sociétés et mythes indo-européens. Théorisée par le français Georges Dumézil dans les années 1930, la tripartition est un des thèmes majeurs des études indo-européennes. Georges Dumézil suggère une division de la société en trois parties : le prêtre souverain, le guerrier et le paysan. Ce dernier pouvant être un éleveur ou un cultivateur. Cette séparation de la société en trois rôles distincts se retrouverait dans toutes les sociétés et mythes indo-européens : des dieux nordiques aux castes indiennes. Dans la mythologie nordique, Odin et Týr incarnent la fonction souveraine, également religieuse et juridique ; Thor incarne le guerrier protecteur ; tandis que Freyr, Freyja et Njörðr, les dieux Vanes incarnent la fertilité et la prospérité. D’après le Rig-Véda, les castes indiennes ont également ces fonctions : prêtres, guerriers, éleveurs, auxquelles s’ajoute également en bas les serviteurs. Chez les Indo-Européens, chaque rôle pourrait avoir une couleur et une mort rituelle spécifique. Le blanc et l’étranglement pour le prêtre souverain ; le rouge et le coup de poignard pour le guerrier ; le noir ou bleu et la noyade pour le paysan.(Anthony, 2007, p. 92) Cette tripartition semble se poursuivre après la mort. Dans un site de la culture Usatovo, cousine des Yamnayas, on retrouve trois types d’enterrements. Le premier cimetière composé de kourganes de chefs accompagnés de dagues en bronze et d’anneaux en argent. Des chefs sans trace de blessure. Le deuxième cimetière est composé de femmes et hommes n’ayant pas les honneurs de porter une arme en métal. Mais pour certains d’entre eux, une arme est la dernière chose qu’ils ont vue car on retrouve des crânes avec des blessures mortelles au marteau. Peut-être la classe des guerriers et peut-être des guerrières, bien que la littérature indo-européenne soit peu encline à présenter les femmes comme guerrière. Enfin, le dernier cimetière est composé de tombes plates et chichement pourvues. (Anthony, 2007, p. 359)
Ceux qui ont déjà lu l’Edda poétique auront peut-être remarqué des similitudes avec le poème Rígsþula, qui justifie l’existence des trois classes sociales par leur création par le dieu Heimdall. Pour les autres, nous en reparlerons, ne vous inquiétez pas. Cette séparation de la société correspond-elle à trois classes sociales différentes dans lesquelles on naît, on grandit et on meurt ? Un peu comme la division Clergé, Noblesse, Tiers-Etat du Moyen-Âge féodal ? Ou y a-t-il des passerelles entre les classes sociales comme cela existe, un petit peu, aujourd’hui ? Ou est-ce que cela correspond à trois âges de la vie d’un homme Yamnaya ? Trois rôles qu’il remplit successivement au sein de sa famille, de son clan ? Après avoir fait le berger toute son enfance, le jeune adulte est initié et devient un guerrier. Puis lorsqu’il hérite du patrimoine familial, il est alors le chef de la famille et c’est lui qui accomplit les rituels et qui est l’intermédiaire entre les dieux et le reste de la famille. Eleveur, puis guerrier, puis chef et prêtre (Anthony, 2007, p. 92)
Nous terminerons cette série d’épisodes par deux mythes proto-indo-européens, qui résument bien tout ce que l’on a découvert sur les Yamnayas au fur et à mesure des épisodes. En comparant plusieurs traditions et archétypes de récits indo-européens, on est capable de reconstruire un récit originel datant des Proto-Indo-Européens, il s’agit des mythes de Manu, Yemo et Trito qui décrivent la cosmogonie proto-indo-européenne, c’est-à-dire le récit de ces peuples sur la création du monde. Voici le résumé que nous fait David Anthony de ces mythes. (Anthony, 2007, p. 134‑135)
Au commencement des temps étaient deux frères jumeaux, Manu et Yemo, dont les noms signifient respectivement « Homme » et « Jumeau ». Ils voyageaient à travers le cosmos, accompagnés d’une grande vache. Tiens, tiens, du bétail. Finalement, Manu et Yemo décidèrent de créer le monde dans lequel nous habitons. Pour ce faire, Manu sacrifia Yemo. À partir des différents éléments de ce corps sacrifié et avec l’aide des dieux du ciel, Manu créa le vent, le soleil, la lune, la mer, la terre, le feu et enfin toutes les différentes sortes d’êtres humains. Manu devint le premier prêtre, le créateur du rituel du sacrifice qui est à l’origine de l’ordre du monde. « Bah eh Manu tu descends ? Eh pourquoi faire ? Bah chépa moi, descends ! »
Plus tard, après la création du monde, les dieux du ciel donnèrent du bétail à Trito, ou le Troisième, le Tiers. Mais ce bétail fut traîtreusement volé par un serpent à trois têtes et six yeux nommé Nghi, que l’on traduit par « Non » et qui est la personnification-même de la négation. Trito demanda au dieu de la tempête de l’aider à récupérer le bétail. Ensemble, ils se rendirent dans la grotte du monstre, le tuèrent et libérèrent le bétail. Trito devint le premier guerrier. Il récupéra les richesses de son peuple et offrit son bétail aux prêtres pour qu’ils en sacrifient une partie. Ce faisant, il fit en sorte que les dieux du ciel reçoivent leur part via la fumée qui s’élève des feux sacrificiels. Ainsi, le cycle des dons entre les dieux et les humains put se poursuivre.
Ces mythes sont fondamentaux dans la culture et les croyances proto-indo-européennes et ils se retrouvent dans des versions différentes dans de nombreuses cultures indo-européennes. Si vous avez été attentifs lors de l’épisode 3 « Glace, feu, géants : la création du monde nordique », vous aurez certainement noté des similitudes avec le mythe que Snorri Sturluson fait réciter par Odin. Le géant du givre Ymir, premier être vivant, correspond évidemment à Yemo, le jumeau tué dont les parties du corps ont servis à construire le monde. Chez les Hindous, Yemo est Yama, le premier mort. Chez les Romains, Yemo est Remus, tué par son frère Romulus lors de la fondation de Rome. Mais avant tout, ces mythes nous montrent un thème récurrent chez les Yamnayas : le bétail est à eux, gare à ceux qui oseraient le leur voler.
C’est la fin de cette série d’épisodes sur les Yamnayas. Grâce à ces 5 épisodes, vous savez comment nous connaissons ce peuple, comment il est apparu dans les steppes et plus généralement qui étaient ces femmes et hommes. Cette longue plongée chez les Yamnayas nous permettra de comprendre profondément ce peuple qui, dans le prochain épisode, va entamer sa diffusion vers l’Europe jusqu’à arriver aux portes de la Scandinavie. La compréhension de la culture Proto-Indo-Européenne nous permettra de comprendre les bouleversements culturels qui vont se dérouler en Scandinavie avec l’arrivée des Indo-Européens. Quant à nos épisodes sur la mythologie nordique, dont une série arrive prochainement, ils seront dorénavant éclairés par la connaissance de l’existence d’une mythologie ancestrale et primordiale. En plus de raconter les épisodes fascinants des Eddas, nous pourrons comparer la mythologie nordique avec les autres mythologies indo-européennes, et nous saurons pourquoi certains récits se ressemblent tant ! Vous allez voir, ça va être fascinant.
Si le podcast vous plaît, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, familles, collègues, qu’ils et elles soient amateurs d’Histoire ou tout simplement curieux. Ca m’aidera à faire connaître le projet et puis ça peut toujours faire des discussions intéressantes au café à base de paléogénétique ou de de linguistique historique ! C’était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l’histoire des vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt !
Bibliographie complète
Sources principales :
- Anthony, D. W. (2007). The Horse, the wheel and language : How bronze-age riders from the eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press.
- Kristiansen, K. et al. (2017). Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe. Antiquity, 91(356), 334‑347.
Sources secondaires :
- Lazaridis, I. et al (2025). The genetic origin of the Indo-Europeans. Nature, 1‑11.
- Olsen, B. A. et al. (2019). Tracing the Indo-Europeans : New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow Books.
- Quiles, C., & root. (2018, avril 12). David Reich on social inequality and Yamna expansion with few Y-DNA subclades. Indo-European.eu
Crédits
- « Heavy Interlude » de Kevin MacLeod. (http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100515). Licence Creative Commons Attribution 4.0.
- L’Avare, Louis de Funès, 1980
- jpfanguin, « Salut à toi jeune entrepreneur »
- Les Inconnus, La Z.U.P
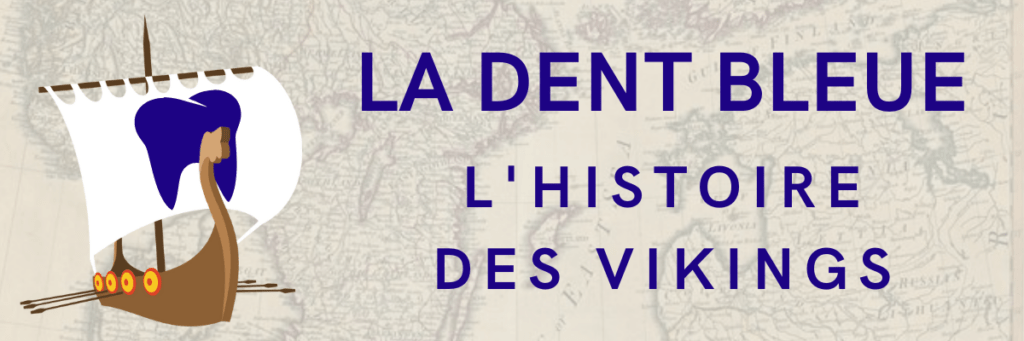
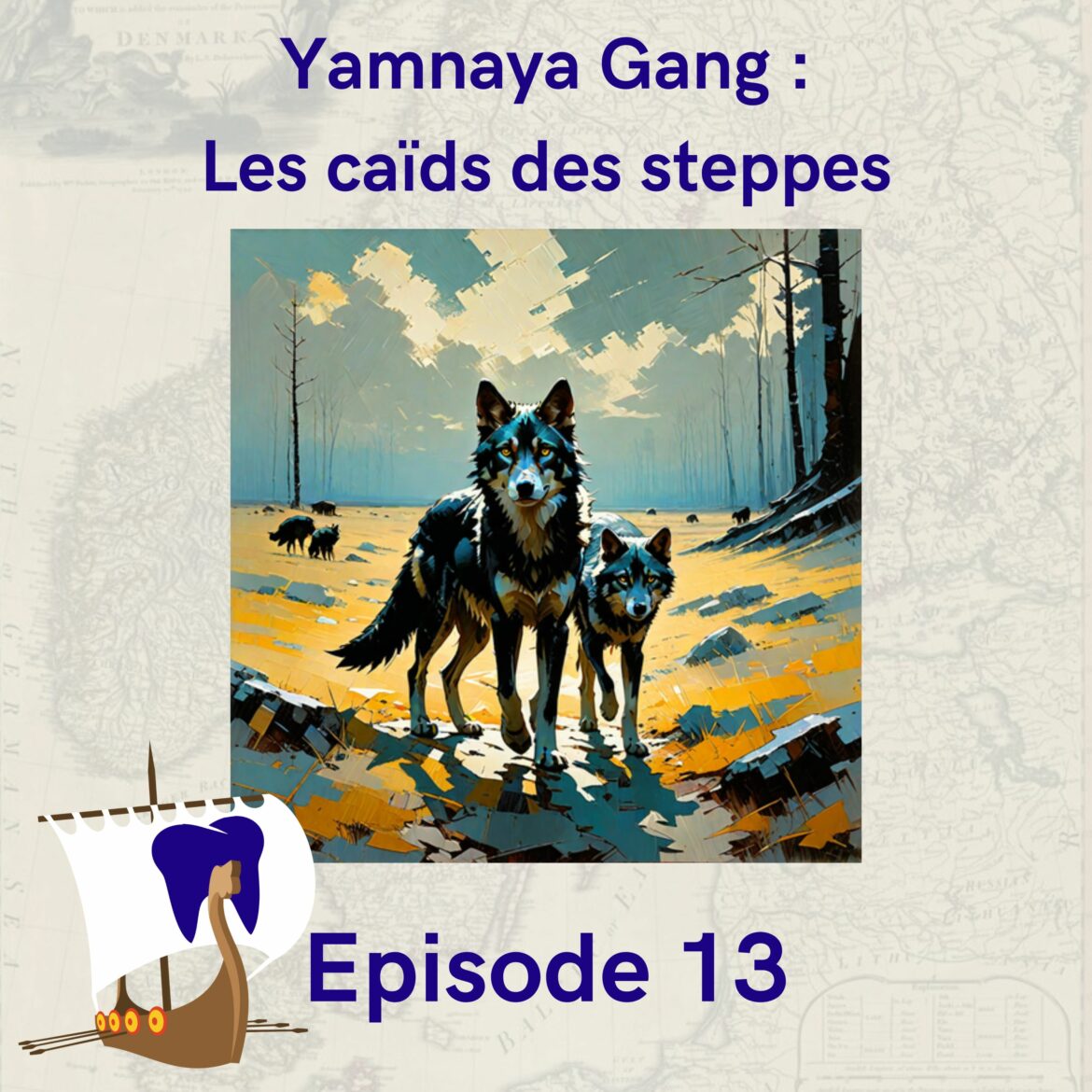
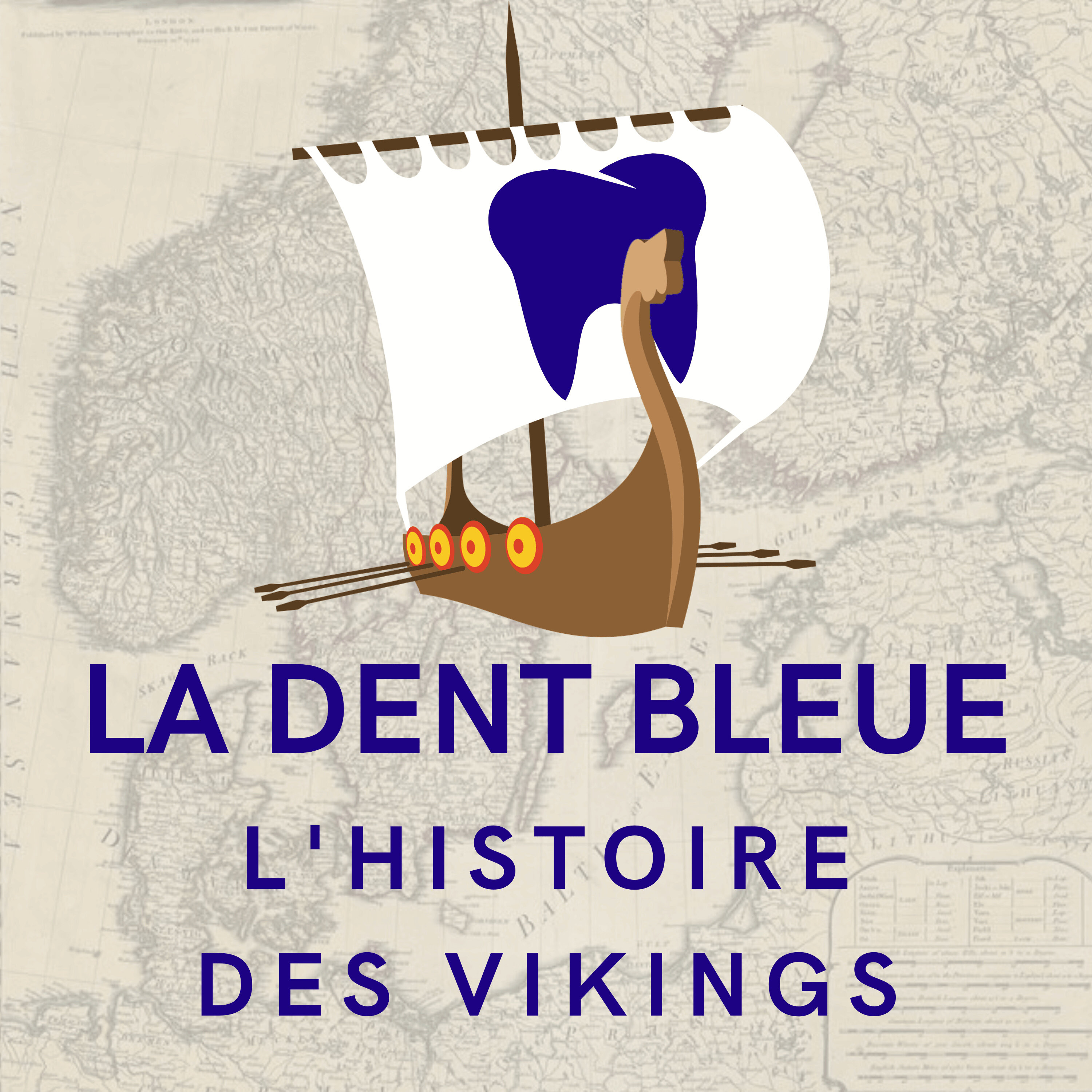
Laisser un commentaire