Ecouter l’épisode
Vous et votre famille marchez dans la steppe, cette immense étendue couverte d’herbes dans laquelle vous êtes né(e) et avez vécu toute votre vie. Toute votre vie dans les steppes, certes, mais pas toujours au même endroit. D’ailleurs, il est temps d’aller vers de nouveaux horizons. Votre grand troupeau de bovins, de chevaux, de moutons et de chèvres a brouté toute la végétation du coin et depuis quelques jours, vous devez les emmener de plus en plus loin du camp. Tout le clan plie les bagages, range les tentes dans les chariots et réattelle les bœufs à ceux-ci. Vous prenez la direction du fleuve le plus proche pour remplir vos poteries d’eau avant de repartir vers la steppe en quête d’un pâturage non exploité par un autre clan. Vous jetez un dernier regard en arrière vers le monticule qui domine le paysage. À l’intérieur de ce kourgane, votre père a été richement enterré la semaine dernière. La vie continue. Et dorénavant, c’est votre frère le chef du clan.
[Générique]
Bonjour. C’est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast “La Dent Bleue, l’histoire des vikings”. Épisode 10 : “Cow-boys nomades : vis ma vie de Yamnaya”. Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l’histoire des vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l’ordre, à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesses et de prestige.
Cet épisode est le troisième d’une série sur les Proto-Indo-Européens que l’on a identifié aux Yamnayas, un peuple qui a été à l’origine de nombreux traits culturels de la société scandinave de la période viking. Et plus généralement, à l’origine de nombreux traits culturels encore existants dans nos sociétés modernes. Les Yamnayas dont nous allons décrire le mode de vie dans cet épisode sont les ancêtres majoritaires des Scandinaves de la période viking. Ce sont pour ces raisons que nous nous attardons particulièrement sur cette population dans le podcast.
Après avoir retracé dans l’épisode précédent les événements qui ont amené à l’apparition des Yamnayas, nous allons aujourd’hui tirer le portrait de cette population. Qui sont-ils ? Comment vivaient-ils ? Etaient-ils vraiment les premiers cavaliers de l’Histoire ?
Introduction
Les études génétiques sont passionnantes. Alors bon, pas forcément à lire, je m’endors souvent devant pour être honnête. Mais dans leurs conclusions, elles apportent des réponses que l’on pensait introuvables il y a quelques années. Des réponses à des débats insolubles entre archéologues et linguistes par exemple. Donc oui, les études récentes de génétique nous aident beaucoup dans notre compréhension de l’Histoire et elles sont beaucoup intervenues dans l’épisode précédent. Mais si la génétique peut retracer les migrations des peuples de façon précise, elle est incapable de nous donner les motivations de ces migrations ni de nous éclairer sur le mode de vie de ces populations, contrairement à l’archéologie, qui le peut. Et grâce aux linguistes, qui ont reconstruit une partie du vocabulaire et de la grammaire du proto-indo-européen, nous pouvons savoir quels étaient les mots qui existaient chez ce peuple. Le vocabulaire, comme la grammaire, porte en lui la façon de voir le monde de ses locuteurs. Enfin, la mythologie comparée nous permet de retracer les mythes de ce peuple, des mythes gardées avec eux dans leur migration : des histoires qui nous permettent d’accéder à des éléments du système de valeur des Yamnayas.
Les Yamnayas montaient-ils un cheval ? Etaient-ils les premiers cavaliers ?
Parmi les aspects essentiels du mode de vie des Yamnayas, le cheval tenait un rôle primordial. En effet, les Yamnayas sont souvent décrits comme des bandes de cavaliers violents qui ont envahi le monde à dos de cheval. Leur maîtrise de l’équitation et des raids équestres leur aurait permis d’obtenir un avantage stratégique décisif pour mener à bien leur invasion au dépend des autres cultures. Mais qu’en est-il vraiment ? Alors attention, comme le cheval va devenir une part importante de notre histoire à partir de maintenant, autant mettre les choses au clair tout de suite. Vous voyez ce que c’est qu’un cheval, j’imagine. Oui ? Eh bien, effacez cette image. Les chevaux sauvages dont on parle ici n’ont vraiment pas grand-chose à voir avec ceux que vous trouverez dans votre club d’équitation local. Les races de chevaux que l’on connaît sont pour la plupart apparues à l’époque moderne par sélection et élevage spécifique. Au Moyen-Âge, les chevaux de guerre étaient plus petits que les chevaux modernes, ils étaient plutôt de la taille de double-poney, contrairement à ce que l’on voit dans la plupart des films d’époque.
Et dans nos steppes, les chevaux sauvages faisaient plutôt la taille de poney mais avec un physique beaucoup plus robuste. Ils ressemblaient un peu à l’unique race de chevaux sauvages existants encore : le Przewalski. (Anthony, 2007, p. 135‑136) À cette époque, de nombreux troupeaux de chevaux sauvages foulaient la steppe pontique, un des rares environnements qui leur étaient encore favorable. Lors du dernier maximum glaciaire, la majorité de l’Eurasie était recouverte d’une steppe-toundra appelée aussi steppe à mammouth. Cet environnement rempli d’herbes et dépourvu d’arbre est idéal pour les chevaux. Mais il y a une dizaine de milliers d’années, cette steppe a été remplacée un peu partout par des forêts vastes et denses. Des forêts qui se sont peuplées d’espèces plus adaptées à cet environnement. À l’aube de la période Yamnaya, les chevaux ne subsistent presque plus que dans les steppes eurasiennes. (Anthony, 2007, p. 197) Ici, ils ont de vastes espaces ouverts adaptés à leur régime alimentaire et à leur capacité à fuir les prédateurs qu’ils peuvent voir arriver de loin. Mais malgré leurs qualités de fuite, ils ne peuvent pas fuir tous les prédateurs. Ces chevaux constituent des cibles de choix pour les chasseurs-cueilleurs locaux qui ont développé des techniques pour les piéger. Le cheval représente environ la moitié de la consommation de viande des chasseurs-cueilleurs de steppes. (Anthony, 2007, p. 197)
Puis vers -5200, ces chasseurs-cueilleurs deviennent éleveurs, à partir de la période Dniepr-Donets que nous avons évoqué dans l’épisode précédent. Eleveurs de bovins, de porcs et de moutons. Mais quelques siècles plus tard [vers -4800], après avoir toujours côtoyé les chevaux en tant que chasseurs, nos éleveurs réussissent à en domestiquer. Domestiquer des chevaux sauvages n’a pas dû être une mince affaire, mais qui d’autres que cette population pour réussir ça ? Ils connaissent le comportement des chevaux, après les avoir chassés depuis des millénaires. Et maintenant, ils maîtrisent l’élevage. Le comportement des troupeaux de bovins et de chevaux sauvages n’étant pas si différent, ils avaient les connaissances et les compétences pour mener à bien ce projet innovant. D’autant que l’ajout du cheval à son cheptel présentait plusieurs avantages. Par exemple, les chevaux n’ont pas besoin de fourrage pour l’hiver. Contrairement aux vaches et aux moutons originaires du Proche-Orient, les chevaux savent naturellement que de l’herbe comestible se cache sous d’épaisses couches de neige. Et ils savent déplacer ces couches de neige avec leurs sabots. Les chevaux sont naturellement adaptés au climat des steppes et à ses rudes hivers. (Anthony, 2007, p. 200‑201)
Ah mais on me signale qu’un expert du plateau tient à intervenir sur la question [OSS 117 : « Le cheval nous voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant, ce n’est que grâce à cela que nous l’avons domestiqué. » ]
Ok… Merci pour l’intervention, mais [Julien Lepers : C’est non !] Pas de preuve sur ça.
Le cheval prend une place importante dans les cultures humaines de la steppe eurasienne. Mais alors, revenons à la question à un million. Nos humains des steppes, les Yamnayas ou leurs prédécesseurs… montaient-ils à cheval ? Etaient-ce des cavaliers ? Eh bien… comme vous vous en doutez, la réponse est plus compliquée que la question. Comme tout changement majeur de l’histoire de l’humanité, l’apparition de l’équitation suscite de nombreux débats et ceux-ci n’ont pas encore trouvé de consensus. Vous avez l’habitude, je vais vous présenter les différents arguments pour que vous puissiez vous faire votre avis. Même si je me suis déjà fait le mien.
David Anthony, l’une de mes sources principales, est l’un des fervents défenseurs et promoteurs de la théorie de la pratique de l’équitation par les Yamnayas et même par leurs prédécesseurs Sredni Stog. Faisons le point sur ses arguments. Tout d’abord, l’archéologue démontre des preuves d’équitation dans la steppe kazakhe vers -3700. Si les arguments qu’il avance pour la domestication du cheval semblent assez solides, l’argumentation pour démontrer la pratique de l’équitation est un peu plus fragile. Son argument principal est la présence, sur plusieurs dents de chevaux de traces d’usures qui seraient liées à des mors. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode. C’est plutôt convaincant, mais assez léger. L’unique autre argument est le changement d’économie qui se produit chez ce peuple, la culture Botai, qui se spécialise dans la chasse aux chevaux. D’après lui, leur capacité à chasser tant de chevaux ne s’explique que par le fait qu’ils devaient les chasser en étant montés sur d’autres chevaux. Voilà les arguments pour les steppes kazakhes. Pour équilibrer, il cite également quelques arguments assez pointus en défaveur de la pratique de l’équitation.
Quoi qu’il en soit, là on parle de la steppe kazakhe, pas de la steppe pontique, située beaucoup plus à l’ouest. Pourquoi Anthony nous amène-t-il ici ? Voici sa démonstration. La steppe kazakhe est l’unique endroit avec des preuves un peu plus tangibles d’équitation dès le 4ème millénaire avant notre ère. Mais leurs voisins de la steppe pontique élevaient des animaux et probablement des chevaux dans le lot, avant ça. Ce sont donc certainement ces voisins éleveurs de la steppe pontique qui ont dû être les premiers cavaliers et qui ont appris ça ensuite aux chasseurs-cueilleurs de la steppe kazakhe. Donc dans la steppe pontique, on maîtrisait l’équitation avant les Botai, donc avant -3700, donc les Sredni Stog étaient des cavaliers. De plus, dans ce millénaire, on retrouverait de plus en plus d’os de chevaux dans les colonies humaines, ce qui montre un changement dans la relation entre les humains et les chevaux. Et à long terme, il serait très difficile de gérer des troupeaux de chevaux sans être monté à cheval, comme un cow-boy. Autre argument pour David Anthony, les éleveurs de la culture Sredni Stog se comportaient comme des cavaliers car ils étaient plus mobiles que leurs prédesseurs comme le prouvent leurs petits cimetières, le fait qu’ils effectuaient du commerce à longue distance et qu’ils pratiquaient des raids dans des communautés agricoles. Et donc, l’équitation a démarré dans la steppe pontique, avec les Sredni Stog, prédécesseurs des Yamnayas. (Anthony, 2007, p. 216‑222)
Voilà le résumé de ses arguments. Bien que David Anthony soit un archéologue reconnu et brillant et que j’ai trouvé son ouvrage de 2007 passionnant avec des démonstrations très claires, je crois que vous avez saisi que je ne suis pas convaincu par celle-ci. Alors pourquoi pas de l’équitation dans la steppe kazakhe, bien que les preuves soient légères. Cependant, en affirmant que ces chasseurs kazakhs auraient appris l’équitation des éleveurs de la steppe pontique, sans aucune preuve tangible, je trouve qu’il s’avance trop. Il n’y a vraiment aucune preuve directe de la pratique de l’équitation dans la steppe pontique.
Quoi que… Dans une publication de 2023, une équipe de chercheur pense avoir trouvé cette preuve manquante, là où ne l’attendait pas. Non pas dans les os de chevaux, mais dans ceux des humains qui les auraient montés. Chez cinq individus Yamnaya, ils ont identifié plusieurs pathologies et changements ostéologiques sur leurs hanches et leur dos. Des pathologies et changements qui sont associés à ceux des cavaliers. (Trautmann et al., 2023) Banco donc ! Et… suffisant pour conclure sur le lien de cause à effet ? Pas tout à fait, car une publication de 2024 remet complètement en question la méthode utilisée dans la précédente (Hosek et al., 2024). Voici les arguments. Les modifications observées sur les os humains sont les mêmes que celles que l’on observe chez les cavaliers, certes, mais ce sont également les mêmes que l’on observe chez les personnes qui conduisent des chariots à bœufs. Des chariots qui étaient eux, clairement attestés archéologiquement dans la culture Yamnaya. La causalité n’a donc pas été prouvée. Retour à la case départ.
Et souvent quand on est bloqués dans des débats sur la préhistoire, qui c’est qui nous vient à la rescousse ? [Bruit de cavalerie] Ben non, pas la cavalerie. On veut prouver son existence justement. La génétique bien sûr ! Rappelons-nous que le cheval moderne est une espèce qui a beaucoup évolué par rapport au cheval sauvage du paléolithique. Alors pourrait-on retracer l’origine ou les origines géographiques du cheval moderne et retracer les dates de diffusion dans le reste du monde ? Tout à fait Jamy, car dans une publication de 2021 (Librado et al., 2021), une équipe de paléo-généticiens a démontré que les chevaux modernes descendent tous d’une espèce de chevaux présente dans la steppe pontique dans les années -3000, soit exactement la période de diffusion de la culture Yamnaya en Eurasie. [Oooooh…] Et cette espèce issue de la steppe pontique a remplacé la quasi-totalité des autres espèces dans toute l’Eurasie. [OOOOOOOH…] Mais ce remplacement a lieu uniquement à partir de -2000, ce qui correspond à l’apparition d’une culture des steppes postérieures, la culture Sintashta, dont la pratique de l’équitation est, elle, attestée archéologiquement sans l’ombre d’un doute. [Musique de déception Bob L’Eponge…] En résumé, les chevaux modernes sont bien issus bien de l’espèce domestiquée par les Yamnayas dans la steppe pontique. Mais la diffusion de ces chevaux dans le reste de l’Eurasie à partir de la steppe pontique a eu lieu environ 1000 ans plus tard. Cette étude réfute donc l’idée d’une expansion massive des Yamnayas grâce à la maîtrise de l’équitation et des raids à dos de chevaux. Les conclusions de l’étude vont plus loin encore. Si les Yamnayas ont emmené des chevaux avec eux dans leur migration, cela a donc été à la marge. Le patrimoine génétique des Yamnayas s’est largement diffusé dans l’Eurasie, mais ce n’est pas le cas de celui de leurs chevaux.
Comment conclure ce débat ? Toutes ces études étant assez récentes, il n’y a pas encore consensus au sein des experts. Donc chacun se fera son avis. Voici le mien, qui vaut ce qu’il vaut. On peut imaginer que pour un peuple qui a domestiqué des chevaux depuis des générations, monter dessus était la suite logique. Mais jusqu’à preuve du contraire, je pense que les Yamnayas n’étaient pas des cavaliers. Ou alors si certains ont monté des chevaux, ça devait être marginal et ça n’a pas été un facteur décisif de l’expansion Yamnaya comme le théorise David Anthony.
Les chariots et la mobilité : la grande innovation des Yamnayas
Mais c’est une autre innovation qui l’a été. Une innovation également liée à la mobilité : les chariots. Les chariots tirés par des bœufs sont apparus en Mésopotamie, autour de l’actuel Irak. (Anthony, 2007, p. 282) La charrue existait déjà, mais là on parle d’un nouveau moyen de transport révolutionnaire. Après la Mésopotamie, les chariots se sont ensuite diffusés au-delà du Caucase (Anthony, 2007, p. 295) pour atteindre les steppes entre -3500 et -3300. (Anthony, 2007, p. 317) On a de nombreuses preuves archéologiques de chariots associés à la culture Yamnaya. On a notamment une dizaine de cas de chariots accompagnant des enterrements sous des kourganes, le nom donné aux monts funéraires Yamnaya. L’espace habitable de ces chariots mesuraient environ 1 mètre de large et 2 mètres de long et les roues mesuraient entre 50 et 80 centimètres de diamètre. Un des chariots qui a été retrouvé conserve des détails très précis. À l’avant, un siège pour le conducteur. À l’arrière, les passagers et la cargaison était couverts par une bâche faite de nattes de roseaux peintes avec des motifs incurvés blancs, rouges et noirs, cousus entre eux. (Anthony, 2007, p. 312)
Les Yamnayas ont pleinement pris la mesure de cette invention et en ont fait leur mode de vie. Le nomadisme. Grâce aux chariots, ils pouvaient transporter en masse de l’eau, de la nourriture et leurs tentes sur de longues distances. Leurs ancêtres étaient confinés autour des lacs et des rivières, ne s’aventurant dans les steppes que pour de brèves chasses aux chevaux sauvages. Mais dorénavant, grâce à leur mode de vie nomade, nos éleveurs peuvent exploiter toute la steppe. Ils peuvent posséder des troupeaux immenses car il n’y a plus de limite à la taille de leur pâturage. La tribu peut s’aventurer loin dans la steppe, monter le camp pour faire paître ses bêtes, dormir dans ses chariots et tentes, puis lever le camp et continuer son chemin. La steppe pontique devient un immense pâturage pour les troupeaux des Yamnayas. (Anthony, 2007, p. 301‑302)
L’élevage nomade était la grande innovation des Yamnayas et a transformé l’économie de la steppe pontique. Mais pouvaient-ils subvenir à tous leurs besoins tout en étant nomades ? Nous verrons plus tard que les raids et le pillage des communautés sédentaires n’étaient pas absent de l’attirail de nos éleveurs nomades. Mais malgré tout, il est possible que les Yamnayas exploitaient eux-mêmes des mines de métaux et qu’ils fabriquaient leurs propres outils et armes. Ils n’étaient pas dépendant des fermiers sédentaires. (Anthony, 2007, p. 322)
D’ailleurs, comment sait-on que les Yamnayas étaient nomades ? Déjà, il y a la présence des chariots, mais ce n’est pas tout. À partir de la période Yamnaya, les kourganes, qui sont les monts funéraires des steppes, commencent à apparaître dans la steppe profonde, loin de tout, loin des fleuves où se concentraient la population auparavant. Des kourganes qui sont utilisés, puis abandonnés, puis réutilisés. Et surtout, alors que des villages le long des rivières étaient présents depuis des générations, toute traces de ceux-ci disparaissent lors de la période Yamnaya. (Anthony, 2007, p. 302‑303, 325) Cette absence de villages fait partie des preuves du nomadisme des Yamnayas, mais rend plus difficile l’étude archéologique du mode de vie de cette population.
L’économie et le mode de vie des Yamnayas
Malgré tout, les archéologues ont plein d’informations à nous donner sur ce mode de vie. Par exemple, que celui-ci n’était pas uniforme. À l’est de la steppe pontique, on est plus sur des troupeaux de moutons alors qu’à l’ouest, dans la région du Dniepr, les éleveurs privilégient les bovins. (Anthony, 2007, p. 327) Ces animaux, quels qu’ils aient été, étaient très importants pour les Yamnayas. Ils étaient le fondement de leur économie, de leur existence. Pour citer David Anthony, ces animaux convertissaient des plaines d’herbes inutiles et hostiles en laine, tissus, toiles de tente, lait, yaourt, fromage, viande, moelles et os : les fondements de la vie et de la richesse de ces éleveurs. Ces animaux représentaient la richesse et le statut social des familles. La taille des troupeaux peut varier rapidement : avec un peu de chance et de bonne gestion, une famille pouvait rapidement faire grossir son troupeau ; mais en cas de mauvais temps ou de vol, le troupeau pouvait décliner tout aussi rapidement. Une économie basée sur l’élevage est plus volatile qu’une économie basée sur la cultivation. La richesse peut se faire et se défaire plus rapidement. (Anthony, 2007, p. 137‑138)
Les linguistes nous permettent également d’en savoir plus sur le mode de vie des Yamnayas, grâce à la reconstruction du lexique proto-indo-européen à partir des langues indo-européennes modernes et anciennes. Voici tout ce que ce lexique nous apprend. On sait par exemple que les Yamnayas avait des mots signifiant cheval (Olsen et al., 2019, p. 139), taureau, vache, bœuf, bélier, brebis, agneau, porc et porcelet. Ce qui confirme leur condition d’éleveurs. Ils avaient également de nombreux termes très détaillés concernant les produits laitiers. Leur vocabulaire nous apprend que des chiens les accompagnaient, probablement pour mener leur bétail. Ils tondaient la laine et l’utilisaient pour tisser. Ils connaissaient l’araire tirée par des bœufs, cette sorte d’ancêtre de la charrue dont nous avons longtemps parlé dans l’épisode 6 « Neolithic Start-Up Nation ». Mais s’ils avaient un mot pour désigner l’engin, cela ne veut pas forcément dire qu’ils l’utilisaient, cela pouvait potentiellement être pour désigner les araires utilisés par les communautés de fermiers avec qui ils commerçaient. Les céréales ne leur sont en tout cas pas inconnus. Les Yamnayas distinguaient l’ivraie du grain. Ils transformaient ce grain en farine en le broyant à l’aide d’un pilon. Leurs aliments étaient cuits dans des chaudrons en argile. Et leurs biens étaient divisés en deux catégories : immobilier et mobilier. La racine du terme désignant les biens mobiliers, principalement les troupeaux, est « peku- », qui a ensuite donné le mot « pécuniaire ». (Anthony, 2007, p. 91) Fascinant ce que la linguistique peut nous apporter à la compréhension de la mentalité de ce peuple.
Que mangeaient les Yamnayas ?
Mais pour connaître la répartition de leur régime alimentaire, l’archéologie et les analyses isotopiques sont nos meilleurs alliés. À l’époque Sredni Stog, celle qui précède l’émergence des Yamnayas, la part de chevaux dans l’alimentation était généralement très importantes. Pour le reste, la répartition diffère selon les régions de la steppe. Proche des rivières, on consomme plus de poissons. Dans le Sud-Ouest, les moutons et chèvres sont les animaux les plus représentés en nombre. Dans le Nord, dans la steppe boisée, la chasse au cerf complète l’élevage. (Anthony, 2007, p. 247)
Pour les Yamnayas, c’est plus compliqué. Comme on l’a vu tout à l’heure, ils sont devenus nomades avec leurs chariots et n’ont donc pas de village. Les seules traces archéologiques qu’ils nous ont laissées sont dans les kourganes. En termes de nombre d’animaux identifiés par leur os, on retrouve deux tiers d’os de moutons et chèvres, suivies dans cet ordre par les bovins, les chevaux et les chiens. (Anthony, 2007, p. 323‑324) Difficile d’interpréter ces informations sur la composition de leur régime alimentaire. Par exemple un cheval ou un bœuf contient beaucoup plus de viande qu’une chèvre. Et d’autre part car on ne peut pas savoir si la répartition des animaux sacrifiés lors des enterrements était représentative de leur régime quotidien.
Mais globalement, on peut déduire un régime alimentaire composé de viande, de lait, de yaourt, de fromage, de soupe de légumes sauvages et peut-être d’un peu de céréales. Et en bonus : du miel et de l’hydromel. Bien que l’on n’ait pas de traces archéologiques de la consommation de miel et d’hydromel par les Yamnayas, ces deux mots ont été reconstruits en proto-indo-européen, respectivement mélit pour miel et médhu pour hydromel, ce qui a donné mead en anglais. La linguistique nous prouve donc la connaissance du miel et de l’hydromel dans cette culture. (Anthony, 2007, p. 301‑302; Mallory & Adams, 2006, p. 260‑261)
Les Yamnayas consommaient des produits laitiers et ont probablement diffusé la tolérance au lactose
Mais revenons un peu sur le lait et les produits laitiers, car ceux-ci ont eu une importance considérable dans le succès des Yamnayas. Eh oui, vous ne l’aviez pas vu venir celle-ci ! Quand j’évoquais dans l’épisode précédent des innovations décisives, vous imaginiez peut-être qu’ils étaient devenus les boss grâce à la fabrication d’armes secrètes ou grâce à la cavalerie. A priori ce n’est ni l’un ni l’autre, mais plutôt [Les produits laitiers sont nos amis pour la vie] Un peu d’explication.
Aujourd’hui, dans les pays occidentaux, on tient pour acquis la capacité à consommer du lait animal. La tolérance au lactose chez les adultes est considérée comme la norme chez nous. Mais c’est une mutation très récente dans la longue histoire de l’humanité. Pour en prendre la mesure, commençons par comprendre comment fonctionne la transformation du lactose. Le lactose est un sucre présent dans le lait des mammifères. Les bébés sont naturellement capables de digérer le lactose grâce à une enzyme appelée lactase. La lactase est sécrétée dans l’intestin grêle et permet de transformer le lactose en d’autres sucres, notamment le glucose qui est ensuite absorbé par l’organisme. Pour tous les mammifères, la sécrétion de lactase diminue à partir du sevrage du lait maternel. Chez l’enfant humain, ce sevrage naturel se produit entre trois et cinq ans. (L’homme est-il vraiment devenu de plus en plus intolérant au gluten et au lactose ?, 2025)
Sans lactase, le corps ne peut plus digérer correctement le lactose et ne peut donc plus vraiment se nourrir de lait. Cette intolérance au lactose se manifeste par tout un tas de trouble digestif qui vont du [bruit de mal de ventre] au [idem] en passant par le [idem]. (Intolérance au lactose – Troubles digestifs, s. d.) Bon, je crois que vous avez compris le concept. Jusqu’au paléolithique, les humains étaient logés à la même enseigne que les autres mammifères sur cette intolérance au lactose après le sevrage.
Puis vient le néolithique et les débuts de l’élevage au Proche-Orient. Les humains commencent alors à consommer du lait animal. Car oui, il est possible de digérer du lait tout en étant intolérant au lactose.
Du fait de la diminution de la sécrétion de lactase, on ne peut pas correctement digérer le lactose. Mais si on trouvait une solution pour éliminer ou du moins diminuer le lactose avant l’ingestion, ça changerait tout ! Et c’est exactement ce qu’il se passe lors de la fermentation du lait. Lors de la transformation du lait en yaourt, en fromage, en petit-lait, en faisselle ou en lait fermenté, aigre ou caillé, le lactose est partiellement éliminé et le produit laitier devient toléré par le corps humain. Lors de cette fermentation, des bactéries digèrent alors le lactose à notre place. Nos ancêtres ont découvert comment consommer le lait de leurs animaux grâce à la fermentation. La preuve archéologique la plus ancienne de la consommation de lait animal fermenté date des années -6000 au Proche-Orient. (Evershed et al., 2008; L’homme est-il vraiment devenu de plus en plus intolérant au gluten et au lactose ?, 2025)
Mais plus tard, une mutation génétique apparaît chez quelques individus, dans une population d’éleveurs. Une mutation qui permet ce qu’on appelle la persistance de la lactase à l’âge adulte. Le corps continue de sécréter cette enzyme après le sevrage et reste donc capable de consommer du lait cru. Cette mutation permettant la tolérance au lactose s’est ensuite transmise à leurs descendants jusqu’à aujourd’hui. Mais cette tolérance au lactose n’est pas uniformément répartie dans l’espèce humaine. En réalité, seuls 25 % de la population mondiale est tolérante au lactose, principalement dans les populations issues d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique de l’Est. (L’homme est-il vraiment devenu de plus en plus intolérant au gluten et au lactose ?, 2025) Mais où cette mutation est-elle apparue et pourquoi est-elle devenue extrêmement majoritaire en Europe ?
À votre avis ? Eh bien d’après les études génétiques, c’est dans la steppe pontique, chez les Yamnayas, que semble apparaître la tolérance au lactose et ce sont eux qui ont transmis ces gênes à la majorité des Européens modernes. (Allentoft et al., 2015; Anthony, 2007, p. 326‑327; Garnier et al., 2017)
Pour les Yamnayas, cette faculté à digérer le lait se révèle très pratique à ceux qui la possèdent. Elle leur apporte un avantage qui accroît leurs chances de survie, de se reproduire et de transmettre cette mutation a leur descendance. (L’homme est-il vraiment devenu de plus en plus intolérant au gluten et au lactose ?, 2025) C’est par cette sélection positive que l’on explique comment une mutation devient majoritaire dans une population.
La consommation de lait et de produit laitier était en effet un des aspects primordiaux du mode de vie des Yamnayas. En adoptant un mode de vie nomade, ces éleveurs ne pouvaient pas se reposer sur la culture des céréales comme les populations fermières. Et en plus, leur environnement était la steppe pontique, un habitat hostile et peu fertile. Certes, la chasse aux chevaux sauvages faisait partie des activités, mais on peut imaginer que c’était une source d’alimentation incertaine et très dépendante des aléas. Et une source d’alimentation beaucoup plus aléatoire que celle des pêcheurs du littoral scandinave lors du mésolithique par exemple. Non, l’économie des Yamnayas n’était ni fondée sur la culture des céréales, ni sur la chasse ou la pêche, elle était fondée sur l’élevage. L’élevage permet à nos nomades d’avoir un stock de nourriture sur quatre pattes qu’ils peuvent transporter avec eux. Mais quand on tape dans le stock, on le fait diminuer. Or, si en plus d’être un stock de nourriture, on utilise ses animaux adultes pour produire de la nourriture supplémentaire, on a alors une source d’alimentation inépuisable et mobile. Les vaches, juments, brebis et chèvres transforment l’herbe des steppes en lait qui peut nourrir toute la tribu.
Les Yamnayas n’ont pas été les premiers humains à inventer la consommation de produits laitiers, on a des preuves de cette consommation en Anatolie environ 3000 ans avant l’apparition des Yamnayas. Mais ils ont probablement étendu cette industrie laitière à un tout autre niveau en termes d’importance. La production laitière est complètement adaptée à leur nouveau mode de vie nomade et a pu jouer un rôle important dans l’explosion démographique de ces éleveurs des steppes. (Garnier et al., 2017; Wilkin et al., 2021)
Dans le lexique proto-indo-européen, on retrouve un champ lexique du lait très riche : lait caillé, petit-lait, lait aigre, traire, etc (Anthony, 2007, p. 91; Garnier et al., 2017) Cela montre l’importance du lait dans la société Yamnaya. (Garnier et al., 2017) Mais une alimentation trop riche en lait pendant l’enfance peut aussi mener à de l’anémie, et on observe justement des symptômes d’anémie sur des os de Yamnayas. (Anthony, 2007, p. 326‑327)
Une autre preuve de l’importance du lait chez les Proto-Indo-Européens se situe dans leurs dents. Ou plus précisément dans le tartre de leurs dents. Dans une publication de 2021, des chercheurs démontrent la présence de protéines de lait, notamment de jument, dans le tartre dentaire des Yamnayas. Cette étude confirme à la fois la consommation de lait et la domestication du cheval par les Yamnayas. (Wilkin et al., 2021) Eh ouais, j’espère que vous penserez à ça lors de votre prochain détartrage chez le dentiste. [Benjamin Tranié : « Bon j’te laisse, j’ai toujours un morceau de viande coincé dans les chicots là, j’ai rendez-vous chez le mécano à 16 heures » ]
À propos de chicots, on notera que les Yamnayas n’avaient aucune carie dans les leurs. Les caries sont favorisées par la consommation de céréales et touchent donc les fermiers du néolithique mais pas les chasseurs-cueilleurs. Si les Yamnayas consommaient des céréales, c’était complètement marginal par rapport à la viande, aux produits laitiers et à quelques végétaux sauvages.
Conclusion
Cette consommation de lait a-t-elle permis aux Yamnayas de grandir, génération après génération, leur donnant un avantage physique ? D’ailleurs, à quoi ressemblaient ces individus ? Quelle était leur couleur de cheveux, de peau ? Et plus intéressant, quelle était l’organisation de leur famille, de leur société ? Y avaient-ils des chefs, des rois, une hiérarchie guerrière ? Quels étaient leurs croyances et leurs rituels ?
Vous découvrirez tout ça dans la suite de La Dent Bleue !
Mais avant la suite, je vous propose un épisode FAQ ! Comme je vous l’annonçait à la fin de l’épisode précédent, le prochain épisode sera une Foire Aux Questions pour répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez poser en rapport avec La Dent Bleue. Des questions sur le projet et le plan du podcast, sur la façon dont j’effectue mes recherches, des demandes de précisions sur des épisodes, des questions sur la période viking… Tout ce que vous souhaitez, j’y répondrais avec plaisir dans les prochaines semaines. J’ai déjà reçu un certain nombre de questions, mais je vous invite à en envoyer encore ! Vous pouvez me les communiquer en message privé sur les réseaux sociaux ou les écrire en commentaire sur Instagram, Facebook, Youtube, Spotify. Sur la communauté WhatsApp du podcast. Ou par mail à maxime@ladentbleue.fr Tous les liens sont sur le site du podcast ladentbleue.fr et aussi en description de cet épisode.
Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast. Merci à tous pour vos commentaires et comme d’habitude maintenant, en voici un, celui de Dunalk qui a commenté sur Youtube : « Incroyable de travail comme toujours, bravo Max ! J’ai toujours bien aimé l’Histoire et là je découvre que les connaissances ne font que s’approfondir avec le temps et qu’on en sait de plus en plus ! Merci pour ton travail ! » Merci Dunalk, ce commentaire me touche beaucoup car c’est l’essence même du projet et de ce que j’essaie de véhiculer à travers La Dent Bleue. Raconter une histoire tout en comprenant comment on la connaît.
C’était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l’histoire des vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt !
Bibliographie complète
Sources principales
- Anthony, D. W. (2007). The Horse, the wheel and language : How bronze-age riders from the eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press.
- Garnier, R., Sagart, L., & Sagot, B. (2017). Milk and the Indo-Europeans. In M. Robbeets & A. Savelyev (Éds.), Language Dispersal Beyond Farming (p. 291‑311). John Benjamins Publishing Company.
- Librado, P. et. al. (2021). The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature, 598(7882), 634‑640.
Sources secondaires
- Allentoft, M. E. et. al. (2015). Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature, 522(7555), Article 7555.
- Evershed, R. P. et. al. (2008). Earliest date for milk use in the Near East and southeastern Europe linked to cattle herding. Nature, 455(7212), 528‑531.
- Hosek, L., James, R. J., & Taylor, W. T. T. (2024). Tracing horseback riding and transport in the human skeleton. Science Advances, 10(38), eado9774.
- Intolérance au lactose—Troubles digestifs. (s. d.). Manuels MSD pour le grand public. Consulté 28 mars 2025, à l’adresse
- L’homme est-il vraiment devenu de plus en plus intolérant au gluten et au lactose ? (2025, mars 25).
- Mallory, J. P., & Adams, D. Q. (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford University PressOxford.
- Olsen, B. A., Olander, T., & Kristiansen, K. (2019). Tracing the Indo-Europeans : New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow Books.
- Trautmann, M. et. al. (2023). First bioanthropological evidence for Yamnaya horsemanship. Science Advances, 9(9), eade2451.
- Wilkin, S. et. al. (2021). Dairying enabled Early Bronze Age Yamnaya steppe expansions. Nature, 598(7882), 629‑633.
Crédits
Musique de générique : « Heavy Interlude » de Kevin MacLeod. ( http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100515 ). Licence Creative Commons Attribution 4.0.
Autres musiques et effets sonores :
- OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, Michel Hazanavicius (2006) (courte citation)
- Question pour un champion, Julien Lepers (courte citation)
- Bob l’éponge, Nickelodeon (courte citation)
- Les produits laitiers (courte citation)
- Benjamin Tranié – Les chicots – Le comptoir (courte citation)
Image de couverture : By HistoryMaker18 – Cropped and edited version of: File:Yamnaya Expansion Map.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131290801
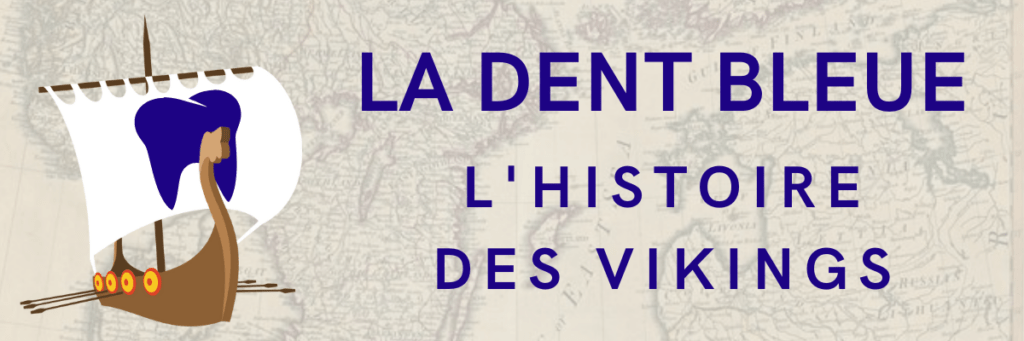
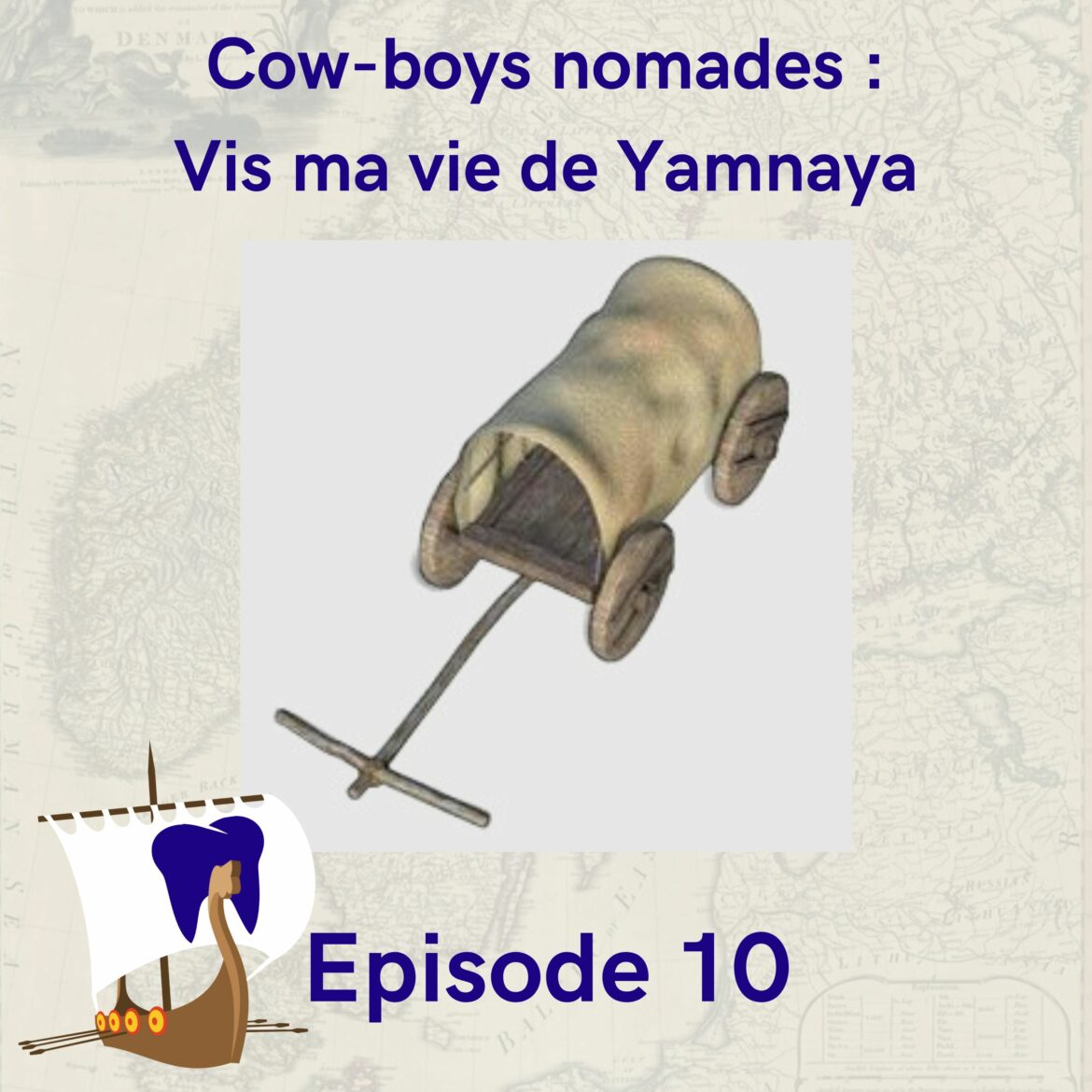
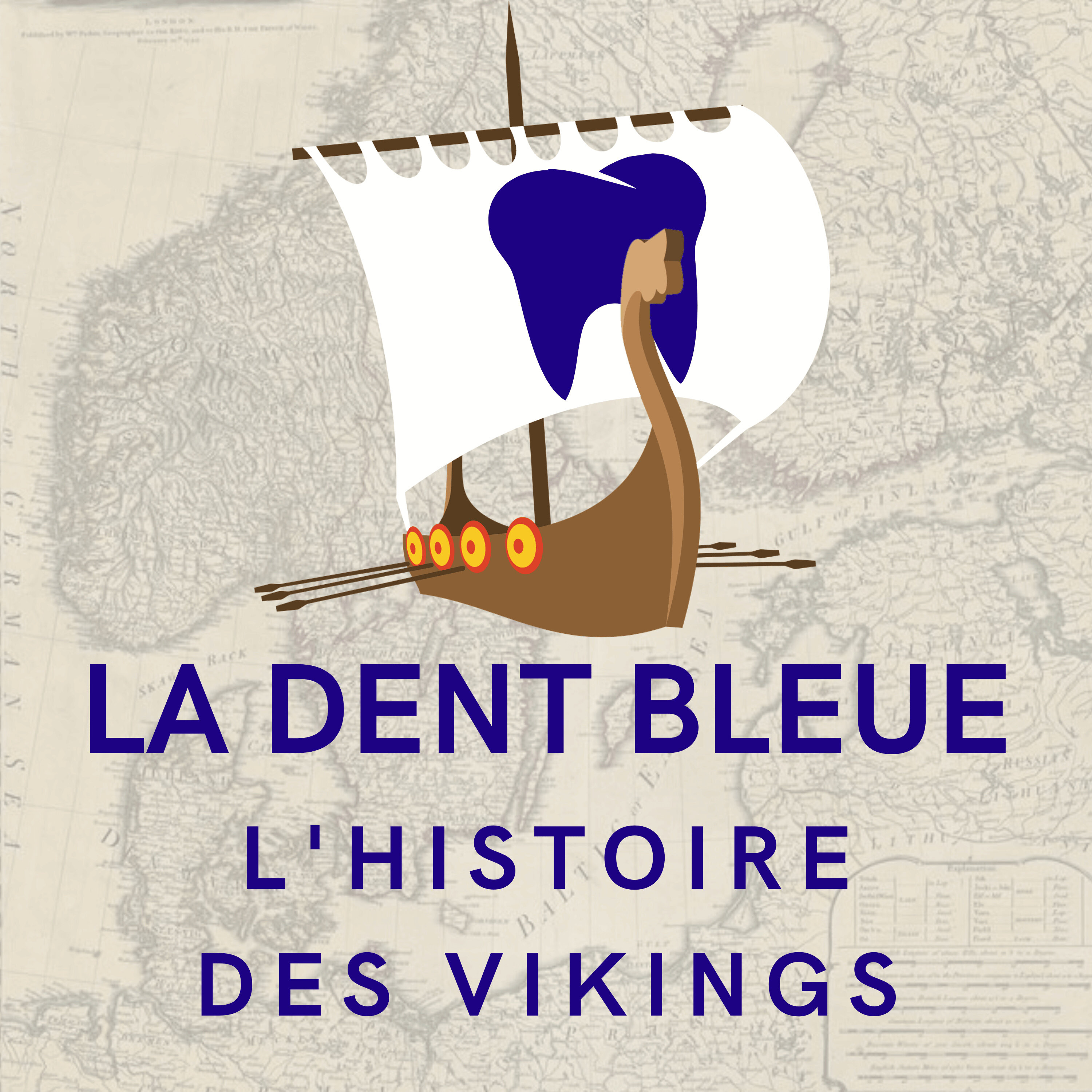
Laisser un commentaire