Crédit photo : hotpot.ai/art-generator & ladentbleue.fr
Ecouter l’épisode
Bonjour. C’est Maxime Courtoison. Bienvenue sur le podcast “La Dent Bleue, l’histoire des vikings”. Épisode 12 : “Yamnayas : macho macho man”.
Ce podcast est un voyage dans le temps pour explorer l’histoire des vikings. Cette émission est chronologique et vous la comprendrez mieux en écoutant les épisodes dans l’ordre, à partir du premier. Nous commençons notre histoire bien avant la période viking, afin de comprendre les mécanismes et événements qui ont fait prendre la mer à des milliers de Scandinaves en soif de richesses et de prestige.
Cet épisode est le quatrième d’une série sur les Proto-Indo-Européens que l’on a identifiés aux Yamnayas, un peuple qui a été à l’origine de nombreux traits culturels de la société scandinave de la période viking. Et plus généralement, à l’origine de nombreux traits culturels encore existants dans nos sociétés modernes. Les Yamnayas dont nous allons décrire le mode de vie dans cet épisode sont les ancêtres majoritaires des Scandinaves de la période viking. Ce sont pour ces raisons que nous nous attardons particulièrement sur cette population dans le podcast.
Les Yamnayas étaient grands, avaient la peau claire et certains étaient blonds
Et d’ailleurs, à quoi ressemblaient-ils physiquement ces Yamnayas ?
D’après plusieurs études génétiques, les femmes et hommes Yamnaya avaient la peau plutôt claire, comme les fermiers européens d’origine anatolienne et les chasseurs-cueilleurs orientaux. (Allentoft et al., 2015) Parmi ces individus, certains avaient les cheveux blonds, hérités de populations sibériennes. Les Yamnayas étaient de grande taille, environ 1m72 pour les hommes (Trautmann et al., 2023), soit 7 cm de plus que leurs voisins fermiers européens d’origine anatolienne. (Mathieson et al., 2015).
Pourquoi étaient-ils si grands ? Était-ce parce qu’ils buvaient du lait ? Une croyance populaire associe la consommation de produits laitiers avec la croissance, ce qui semble prouvé par plusieurs études (Dor et al., 2022) Et on a vu dans l’épisode 10 que les Yamnayas étaient probablement à l’origine de la tolérance au lactose dans les sociétés occidentales. Qu’en plus de consommer des produits laitiers comme leurs voisins fermiers, ils pouvaient également boire du lait cru. Mais dis donc, les Yamnayas étaient grands ET ils buvaient du lait ? Se pourrait-il qu’il y ait un lien ?
Eh bien… Oula je suis gêné. Oui, car en fait je me suis trompé dans l’épisode 10. Il est bien possible que les Yamnayas n’aient pas été tolérants au lactose. [Oh la boulette ! J’ai fait la boulette !]
Alors attention, je ne suis pas le seul à m’être trompé ! Je me suis basé sur des études génétiques de 2007, 2015 et 2017. (Allentoft et al., 2015; Anthony, 2007, p. 326‑327; Garnier et al., 2017) Ces études indiquaient une origine possible dans les steppes de la tolérance au lactose et elles ont été largement reprises.
Mais il semble que cette théorie soit fausse. Les tolérants au lactose sont bien issus des Yamnayas, oui. Mais cette tolérance serait apparue bien plus tard dans l’histoire de l’humanité. C’est ce que démontre une étude génétique de 2020 publiée dans la revue Cell. Cette publication est plus récente que les autres et focalise sur la question de la persistance de la lactase à l’âge du bronze. (Burger et al., 2020) De -3 000 à -1 000, le gène de la tolérance au lactose était encore très rare parmi les nombreux individus étudiés. La tolérance au lactose s’est donc répandue bien plus tard que ce qui était théorisé initialement. Les Yamnayas ne buvaient donc pas leur gobelet de lait au petit déjeuner.
Attention, cela ne change pas l’importance considérable qu’avait le lait pour les Yamnayas. Simplement, ils le consommaient plutôt sous forme fermentée, comme les autres éleveurs du néolithique, et non sous forme de lait cru, comme on le pensait. Cette consommation intense de produits laitiers combinée à l’utilisation de chariots sont les deux grands éléments qui ont permis aux Yamnayas d’être nomades et de pouvoir pleinement exploiter les steppes.
Reformulons alors notre question initiale : est-ce que c’est cette consommation importante de produits laitiers qui a permis aux Yamnayas d’être plus grands que les fermiers européens du néolithique, qui avaient une alimentation plus basée sur les céréales ? Quelques publications étudient la question (Stock et al., 2023), mais pour l’instant il n’y a rien de probant malheureusement. C’est souvent le cas avec les études cherchant à expliquer l’évolution de la taille à travers l’histoire. La taille est un caractère avec des facteurs environnementaux et génétiques. Et pour ce qui est des facteurs génétiques, la taille est polygénique, c’est-à-dire influencée par des gènes différents. La question reste donc en suspens. Pourquoi étaient-ils grands alors ? Probablement un mélange de patrimoine génétique favorable, de régime alimentaire et de sélection naturelle.
Gims vs Yamnayas
En 2023, le rappeur Gims a fait perdre des cheveux aux amateurs d’Histoire lorsqu’il a donné sa version de l’histoire de l’Afrique, qui est d’après lui cachée au grand public. Je ne vais surtout pas revenir sur tout ce qu’il a dit, pas besoin de tirer sur l’ambulance, ses propos ont été suffisamment discrédités par des sources sérieuses. Bon, même si ce n’était pas très dur car il a quand même affirmé que les pyramides étaient des antennes. Je voulais revenir sur une autre de ses affirmations. La voici : « L’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens, on les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les « vrais » Européens qui venaient d’Asie. On les appelait les Yamnayades. »
Si vous aviez déjà entendu cette citation, c’était peut-être la première fois que vous entendiez le nom de Yamnaya. Et alors finalement, après tout ce qu’on a découvert sur la migration des Yamanayas en Eurasie, est-ce que Gims n’aurait pas raison ?
On va reprendre cette affirmation point par point. Je passe sur le nom « Afropéens » qui n’a pas de sens dans ce contexte. « L’Afrique a peuplé l’Europe avant les Européens ». Et beeeeen oui. Mais tout le monde le sait, non ? C’est enseigné dès l’école primaire qu’Homo Sapiens est apparu en Afrique avant de se disperser partout dans le monde. Notre espèce est sortie d’Afrique vers -60 000 (Beyin, 2011) et est arrivée en Europe vers -43 000 (Fu et al 2016), prenant la place des Néandertaliens. Donc, oui, l’Afrique a peuplé l’Europe mais ce n’est pas un secret.
Ensuite, « Ils ont été décimés par les « vrais » Européens qui venaient d’Asie. On les appelait les Yamnayades. » J’en ai parlé dans les épisodes précédents, plusieurs études génétiques ont démontré qu’à partir de -3 000, des individus originaires de cette culture Yamnaya des steppes sont devenus les ancêtres majoritaires des individus Européens. Donc Gims a raison ? Eh bien en fait tout est dans la nuance et c’est pour ça que je souhaite rentrer dans les détails dans ce podcast. C’est pour éviter que l’on parte avec des simplifications et des conclusions hâtives qui vont dans un sens préconçu que l’on peut avoir. Il est bien probable que la diffusion des Yamnayas en Europe n’ait pas été pacifique, même si on ne peut pas l’affirmer avec certitude. Ce remplacement génétique peut également être lié à une plus grande natalité liée à un avantage ou une domination économique, mais nous reparlerons de ce point très important en détail dans les épisodes suivants. Mais là où Gims se trompe complètement, c’est dans le fait de dire que les « Africains » d’Europe ont été remplacés par les « vrais » Européens venus d’Asie. Dans La Dent Bleue, nous avons suivi les multiples changements de population qui sont intervenus depuis le peuplement de l’Europe par Homo sapiens. Mais toutes ces populations, toutes avaient de lointaines origines africaines.
Pour bien comprendre, faisons une passe très rapide sur les mouvements de population en Europe de l’Ouest depuis le paléolithique. En -43 000, les premiers Homo sapiens entrent en Europe, formant la culture de l’Aurignacien. Eux ou leurs ancêtres viennent évidemment d’Afrique. Puis une douzaine de milliers d’années plus tard, grosse climatisation mondiale et c’est le dernier maximum glaciaire qui dépeuple une grande partie de l’Europe. C’est là que les premiers héros de La Dent Bleue sont apparus, les Magdaléniens, installés autour du Sud-Ouest de la France. Vous vous souvenez d’eux j’espère ! [bruit de bouche] Oui et j’espère que vous vous souveniez de mon petit bruitage. D’après les études génétiques, nos cannibales préférés sont issus des premiers Homo sapiens arrivés en Europe 25 000 ans plus tôt. Quand le climat commence à se réchauffer, ce peuple a ensuite repeuplé l’Ouest de l’Europe à partir de -18 000, au fur et à mesure que la vie reprenait du terrain. 6 000 ans plus tard, vers -12 000, place aux Epi-gravettiens, une autre population de chasseurs-cueilleurs qui étaient installés autour de l’Italie et des Balkans lors du dernier maximum glaciaire, leurs ancêtres sont arrivés plus tard en Europe mais sont également issus du groupe sorti d’Afrique vers -60 000. [Voir épisode 2 pour toutes les sources] Puis encore 6000 ans plus tard, vers -6 000, les fermiers d’Anatolie remplacent génétiquement les chasseurs-cueilleurs occidentaux dans l’ouest de l’Europe. [Voir épisode 5 pour toutes les sources] Et ces fermiers d’Anatolie sont issus du même groupe sorti d’Afrique vers – 60 000. Et pour terminer, 3000 ans plus tard, vers -3000, les éleveurs Yamnaya issus de la steppe pontique prennent le gros de la place en Europe (Haak et al 2015, Allentoft et al 2015). Des Yamnayas qui sont également issus du même groupe d’humains sorti d’Afrique vers -60 000. Si je vous ai donné beaucoup de dates, ce n’est pas pour vous rappeler des traumatismes de vos cours d’Histoire du collège, mais pour essayer de donner une distance mesurable entre ces différents événements. Oui, il y a eu des changements majeurs de population en Europe à la préhistoire. Mais non, on ne peut pas dire qu’une population d’Africains ayant peuplé l’Europe en premier s’est fait remplacer par des vrais Européens venus d’Asie. Toutes ces populations qui se sont remplacées chacune leur tour provenaient du même groupe d’humains qui avaient quitté l’Afrique des dizaines de milliers d’années plus tôt. En un sens, tous étaient Africains, ou plutôt, aucun ne l’était.
Maintenant, peut-être que ce que Gims avait en tête était lié à la couleur de peau, donc voyons ce que nous dit l’ADN à ce sujet. Les premiers chasseurs-cueilleurs d’Europe de l’Ouest, avaient la peau sombre. À l’Est, du fait d’une mutation génétique qui a eu lieu après la sortie d’Afrique de leurs ancêtres, les chasseurs-cueilleurs avaient la peau plus claire. Et enfin dans le Nord, en Scandinavie, où nous avons vu que la population du paléolithique était un mélange de chasseurs-cueilleurs occidentaux et orientaux, la peau des individus était de couleur intermédiaire. C’est l’arrivée des fermiers d’Anatolie qui va amener la peau claire dans le patrimoine génétique des Européens de l’Ouest. Et lorsque les Yamnayas à la peau claire vont arriver en Europe, les populations qu’ils y rencontrent ont également la peau claire. (Hanel & Carlberg, 2020) Donc, si le sujet était la couleur de peau, Gims n’a pas tort en disant qu’une population à la peau claire, venue d’Asie, a remplacé des populations à la peau plus sombre, les chasseurs-cueilleurs occidentaux. Sauf que ce ne sont pas les Yamnayas des steppes qui ont amené la peau claire en Europe occidentale, ce sont les fermiers d’Anatolie, 3 000 ans plus tôt. À l’est et au nord de l’Europe, au-delà de la zone néolithique, les Yamnayas ont également remplacé les populations locales, qui étaient des chasseurs-cueilleurs à la peau claire. Mais je le répète, dans tous ces remplacements de populations, en aucun cas ce n’étaient des Asiatiques qui remplaçaient des Africains. Tous avaient de loiiintains ancêtres africains sortis du continent des dizaines de milliers d’années plus tôt. Comme je l’ai dit tout à l’heure, ils étaient tous Africains, ou plutôt, aucun ne l’était. Aucun car, je vais m’avancer, mais à mon humble avis, c’est peu probable que le souvenir d’un départ de leurs ancêtres du continent africain ait fait partie de leur mémoire collective, plus de 50 000 ans après les faits. Je sais que c’est difficile de concevoir un temps aussi long, mais essayons. 50 000 ans, ça correspond à 2000 générations de 25 ans. C’est long. Disons-nous aussi qu’entre la sortie d’Afrique des Homo sapiens qui ont peuplé le reste du monde et les Yamnayas, il y a 8 fois plus de temps qui s’est écoulé qu’entre les Yamnayas et aujourd’hui. Ni les chasseurs-cueilleurs européens, ni les fermiers anatoliens, ni les Yamnayas des steppes ne peuvent réellement être considérés comme des Africains au néolithique.
Voilà, mon but n’est vraiment pas de me moquer. Gims n’est pas un expert en Histoire, il a juste voulu partager des histoires qui l’ont intéressé lors d’une interview. Mais la célébrité du chanteur donne forcément une grande caisse de résonnance à ses propos, qui sont faux, et il est important d’y apporter un contrepoids avec des faits. Et si quelques détails comme la peau claire des Yamnayas pourraient éventuellement faire penser que ces propos sont véridiques, on voit que dès que l’on rentre dans les détails, cela ne fonctionne pas. Comme d’habitude, toutes les sources, qui sont des publications dans des revues scientifiques de pointe, sont notées dans le script sur ladentbleue.fr.
Organisation familiale et patriarcat chez les Proto-Indo-Européens
Nous savons que le mode de vie des Yamnayas était un pastoralisme nomade. Mais la vie de ces personnes ne se résumait pas qu’à leur gagne-pain. À la base de la société Yamnaya, on trouve la famille. Mais qui sont les individus qui composent cette famille ? En général, le foyer est composé du maître et de la maîtresse de maison, de leurs fils, de leurs belles-filles – qui sont donc donc les femmes de leurs fils – de leurs filles non-mariées et de leurs petits-enfants. (Olsen et al., 2019, p. 148‑149)
Pour bien comprendre à la fois les implications de cette organisation et les éléments qui nous permettent de démontrer celle-ci, je vais vous immerger dans un mariage Yamnaya et nous allons prendre deux points de vue différents. Celui du jeune marié et celui de la jeune mariée.
Si vous êtes le marié, vous continuez à vivre chez vos parents, comme c’était déjà le cas avant le mariage. Votre femme vous a rejoint et vos enfants naîtront et vivrons ici. Si vous avez des frères, il en va de même pour eux : la fratrie reste ici. Si vous avez des sœurs, elles restent à la maison jusqu’à ce qu’elle se marient. Elles partirons alors pour rejoindre la maison de leurs beaux-parents.(Anthony, 2007, p. 328) En proto-indo-européen, les racines du mots mariage signifient « mener » et « tirer » exclusivement du point de vue de l’homme, qui mène ou tire sa fiancée dans un foyer distant. Cela signifie-t-il que les hommes kidnappent les femmes pour se marier avec elles, comme dans l’épisode de l’enlèvement des Sabines contenue dans l’histoire mythologique de Rome ? Peut-être que cela arrivait, mais il est probable que cela n’était pas le plus courant. Ce qui est probable cependant, c’est que ce que l’on appelle en anthropologie le « prix de la fiancée » doive être payé à la famille de la mariée. (Olsen et al., 2019, p. 154)
En vous mariant, vous vous êtes lié à une autre famille. Dans le vocabulaire proto-indo-européen, on retrouve les termes de beau-père et de beau-frère qui désignent le père et le frère de la mariée. Cela signifie que ces rôles avaient une importance car ces mots ont été transmis dans les langues indo-européennes après la diffusion des Yamnayas. Au contraire, on ne trouve pas de mot en proto-indo-européen pour la sœur de l’épouse. Quant à la mère de l’épouse, on retrouve un terme commun dans plusieurs langues indo-européennes, mais ce n’est pas aussi marqué que pour beau-père et beau-frère. Il semble donc que pour vous, l’homme marié, seuls les hommes de la famille de votre épouse sont dignes d’importance. L’origine des termes qui désignent le beau-père et le beau-frère est liée à la notion de lien et de loyauté. En vous mariant, vous avez gagné des alliés masculins dans la famille de votre épouse.
Maintenant, prenons le point de vue de la mariée. Vous rejoignez physiquement la famille de votre mari en vivant au sein de celle-ci. Le vocabulaire proto-indo-européen pour désigner les membres de votre nouvelle famille est très étendu et il existe un terme pour désigner chaque personne selon le lien qu’elle a avec vous : le frère de votre mari, la sœur non-mariée de votre mari et même la femme du frère de votre mari. Tous ces éléments démontrent une société patrilocale où les femmes rejoignent la famille de leur mari. D’ailleurs, le terme pour désigner la femme du frère du mari pourrait signifier « voyageuse », ce qui renforce l’idée que les femmes viennent d’une autre famille. (Olsen et al., 2019, p. 152‑154)
Dans cette famille que vous avez rejointe, vous n’avez pas de terme spécifique pour le père de votre mari, votre beau-père, mais vous en avez un pour désigner la mère de votre mari, votre belle-mère. Cela pourrait signifier que la maîtresse de maison jouait un rôle plus spécifique auprès des pièces rapportées. Il est possible que, comme c’est encore le cas dans les familles traditionnelles indiennes, la mère du mari soit la boss des femmes et enfants de la maison, tandis que le père est le chef des hommes. (Olsen et al., 2019, p. 153)
Si vous n’avez pas de terme spécifique pour le père de votre mari, c’est que vous l’appelez « phtér », comme tout le reste de la famille. Ce mot, qui a donné « père » dans les différentes langues indo-européennes, pourrait dériver d’un terme signifiant « protecteur » ou encore « berger ». Le père est donc le protecteur de la famille et celui du troupeau qui assure la prospérité de la famille. (Olsen et al., 2019, p. 146) Quant à vos enfants, ils appelleront leur grand-père par un terme signifiant « père du père ». Logique. Cependant, on ne retrouve pas de trace dans le lexique proto-indo-européen d’un terme désignant l’autre grand-père, le père de la mère. Une preuve supplémentaire de la patrilocalité des familles.
Et maintenant, ne parlons pas de malheur, madame, mais que se passerait-il si votre mari décédait avant-vous ? Dans le Rig-Veda, sorte d’ancien testament de l’hindouisme, la pratique suivante est mentionnée : les veuves doivent se marier au frère du défunt mari. Il semblerait que cette pratique ait été assez répandue dans les premières sociétés indo-européennes. Il est d’ailleurs probable que le mot pour « veuve » en proto-indo-européen signifie « allouée », c’est-à-dire que la veuve serait allouée au frère suivant. Alors, pourquoi une telle institution ? Il y a des intérêts communs à une telle pratique. La veuve et ses enfants conservent la protection de la famille du défunt mari, les deux familles conservent leur alliance telle quelle et le frère récupère une femme sans avoir à payer le prix de la fiancée car celui-ci a déjà été payé. Ça fait faire des économies à la famille. Un peu comme quand le petit frère prend les vêtements trop petits du grand frère, mais là c’est sa veuve. La grande classe. Cela permet également de garder dans la famille l’héritage des éventuels garçons (Anthony, 2007, p. 328) devenus orphelins. Et ceux-ci bénéficient ainsi d’un protecteur, leur oncle et nouveau beau-père. Il est d’ailleurs possible que le terme proto-indo-européen pour « orphelin de père » signifie littéralement « changement d’allégeance ». Un orphelin transfère donc son allégeance de son père à un autre homme, souvent un membre de la famille.
L’héritage se transmet de père en fils, c’est la patrilinéarité. Mais un système est prévu si une famille n’a pas de fils : c’est l’institution des filles héritières. Les filles vont avoir la fonction intermédiaire d’héritière le temps qu’elles produisent un fils qui deviendra alors l’héritier légitime de la famille. Des règles très précises sur ce cas de figure sont conservées dans les textes de la tradition grecque et indo-aryenne. Un texte crétois précise avec qui une fille héritière doit se marier pour conserver l’héritage intact et ré-établir la lignée masculine : en premier choix le plus âgé de ses oncles paternels, sinon le plus âgé des neveux via son frère le plus âgé, etc. (Olsen et al., 2019, p. 155‑156)
Dans plusieurs langues indo-européennes, on retrouve des termes signifiant « fils d’une héritière » ou encore « fils d’une fille ». On retrouve un exemple chez Sven Estridsen, roi du Danemark de la fin de la période viking, qui a pris le nom de sa mère et non de son père, rompant ainsi avec la dénomination habituelle. Car sa mère, Estrid était la fille du roi du Danemark et d’Angleterre Sven à la barbe fourchue. Sven II était désigné comme Estridsen, fils d’Estrid, car ses prétentions au trône danois passaient par sa lignée maternelle.
Mais ne parlons pas de malheur, votre mari est toujours vivant, vous avez deux garçons, ils sont en bonne santé, et vous avez même une fille. Le terme proto-indo-européen pour fille d’ailleurs, est « dhuhgtér », très proche de l’anglais « daughter » et son sens original est « la fille qui trait les animaux », ce qui était donc probablement le rôle traditionnel des jeunes filles dans les sociétés pastorales indo-européennes. (Olsen et al., 2019, p. 147)
Vous avez deux fils, mais le plus jeune n’habite pas avec vous. Vous l’avez confié dès le plus jeune âge à votre frère pour qu’il l’élève dans sa famille, votre famille. Cette pratique appelée fosterage est d’après la linguistique très commune dans les sociétés indo-européennes. 4000 ans plus tard, dans la période viking héritière des Indo-Européens, le fosterage est une pratique très répandue et largement documentée dans les sagas. (Olsen et al., 2019, p. 157) D’ailleurs, le terme français « fosterage » est originaire du germanique. Et potentiellement du vieux normand qui est un dialecte influencé par le vieux norrois. De nombreuses sagas islandaises mentionnent le cas de garçons élevés dans d’autres familles. Attention, on ne parle pas ici d’adoption : le garçon reste le fils de ses parents, mais il est élevé et nourri par une autre famille amie. Se faisant, le garçon noue une alliance précieuse qui lui sera utile lorsque, par exemple, il aura besoin d’aide pour se venger à propos d’une sombre histoire de mouton volé ou de bois coupé dans la mauvaise forêt. Aaaah l’Islande et ses faits divers romancés ! J’ai vraiment très très hâte de vous raconter les sagas.
La reconstitution du vocabulaire proto-indo-européen nous dessine donc une société Yamnaya organisée de façon patriarcale. Regardons maintenant du côté de la génétique et de l’archéologie pour voir si ce patriarcat se retranscrit dans les gènes et les restes matériels.
Eh bien encore une fois, la génétique confirme les idées de la linguistique ! Pour démontrer ça, faisons un petit détour par l’Allemagne et la culture campaniforme. La culture campaniforme est une culture indo-européenne héritière de la culture Yamnaya. 34 individus de deux cimetières campaniformes ont été analysés à travers une approche interdisciplinaire : archéologie, paléogénétique et analyse isotopique. (Sjögren et al., 2020) Tout ce qu’on aime ici.
Que nous dit la génétique ?
Exogamie et patrilocalité : oui.
Fosterage d’enfants : oui
Des questions ?
Bon, vous vous doutez bien que je vais vous expliquer un peu ce qui permet d’affirmer ça, ce n’est pas le genre de la maison de vous balancer des infos comme ça.
La génétique nous montre que ces cimetières contiennent des individus de mêmes familles, qui peuvent aller jusqu’à six générations différentes. La génétique, toujours, permet d’identifier une faible variabilité sur les gènes du chromosome Y transmis uniquement par les pères et une plus grande variabilité sur l’ADN mitochondrial transmis uniquement par les mères. Traduction : les individus enterrés ici sont issus de mêmes lignées masculines, mais de nombreuses lignées féminines. Génération après génération, les hommes restent, tandis les femmes arrivent d’ailleurs.
Puis l’analyse isotopique couplée à l’analyse génétique permet d’identifier les individus étrangers au village. Et la grande majorité des individus non locaux sont des femmes. Ce qui nous conforte dans l’idée de la patrilocalité – les femmes viennent habiter dans le village de leur mari – et de l’exogamie : les femmes viennent de loin. Ce dernier point est identifiable grâce à l’analyse isotopique qui permet d’avoir des indices sur le lieu où la personne a vécu.
Et justement, c’est cette même analyse qui permet de démontrer le fosterage d’enfants. Un des adultes inhumés fait partie de la lignée masculine locale mais a une signature isotopique extérieure. Cela signifie qu’il a grandi ailleurs avant de revenir vivre dans sa famille.
Les conclusions des linguistes sur les structures familiales des Proto-Indo-Européens semblent donc confirmées par cette étude !
Maintenant, prenons en compte l’archéologie pure et revenons 1000 plus tôt, dans notre bien-aimée steppe pontique. (Anthony, 2007, p. 328‑329) Les Yamnayas étaient nomades et donc les seuls restes qu’ils nous ont laissés sont leurs tombes. Les fameuses kourganes, monts funéraires construits au-dessus des sépultures où sont enterrés les défunts.
Ces kourganes n’étaient pas des cimetières familiaux, on pouvait y enterrer des personnes de familles différentes. Mais attention, pas n’importe qui ! Il existe plus de 2 000 kourganes Yamnaya, mais celles-ci sont réparties sur une zone géographique et temporelle très vaste. Dans toute la région de la moyenne Volga par exemple, il n’y a eu en moyenne qu’une kourgane construite tous les cinq ans. Et ces kourganes ne contenaient que très peu de tombes, très peu d’individus. Entre un et trois la plupart du temps. Les kourganes, LE marqueur de la culture Yamnaya, n’était donc destiné qu’à une élite, en tout cas à certaines personnes qui méritaient une distinction plus grande que le reste de leurs congénères. J’ouvre une petite parenthèse pour faire remarquer que c’était la même chose pour les fermiers scandinaves lors de la première phase de la culture des vases à entonnoir. En Scandinavie, sur un demi-millénaire d’occupation par les fermiers, on n’a retrouvé qu’une quarantaine de tumulus, qui ne contenaient en général qu’un seul défunt. Les fermiers avaient ensuite basculé sur un modèle plus collectif avec des dolmens qui servaient de tombes collectives.
La linguistique, la génétique et les autres sciences historiques ont reconstruit une société proto-indo-européenne qui serait patrilocale, c’est-à-dire où le couple vit dans la famille du mari ; mais aussi patrilinéaire, c’est-à-dire que les garçons héritent du patrimoine. C’était donc très probablement une société patriarcale, avec un pouvoir et une autorité appartenant principalement aux hommes. Si c’était le cas, alors cela devrait se ressentir dans les tombes. Si la classe d’élites n’était composée que d’hommes, alors on ne devrait retrouver que des hommes dans les kourganes.
Qu’en est-il ? Eh bien… ça dépend. Ça dépend des régions en fait. Sur toute la steppe pontique occupée par les Yamnayas après leur première diffusion depuis l’Ouest, différentes variantes semblent exister selon les régions. Autour de la Volga, à l’est de la steppe pontique, 80% des tombes Yamnayas sont occupées par des hommes. Et dans les kourganes, la tombe centrale est bien plus souvent occupée par des hommes. À l’Ouest, en actuelle Ukraine, plus proche du berceau initial des Yamnayas, on a une prédominance des hommes dans les tombes, mais pas autant qu’à l’Est. Dans le Sud, plus proche du Caucase, on est sur une égalité hommes-femmes 50-50 en ce qui concerne le nombre de tombes et la façon dont ces individus ont été enterrés.
Que peut-on conclure de ces informations ? Plusieurs choses.
Si au Sud, proche du Caucase, la tendance est bien différente du reste de la steppe et pourrait peut-être être due à une influence de peuples extérieurs, pour le reste, l’archéologie nous montre que les Yamnayas ont globalement une préférence masculine dans leur classe d’élite. Pour cette société, les hommes méritent plus d’égard dans leurs funérailles que les femmes. On remarque aussi qu’il semble y avoir un gradient Ouest-Est en ce qui concerne l’importance des femmes au sein des sociétés Yamnayas. Je parle depuis le début de la culture Yamnaya pour simplifier, mais les archéologues comme David Anthony préfèrent parler d’horizon Yamnaya, tant cette culture est vaste et multiple. La reconstruction du Proto-Indo-Européen par les linguistes peut nous faire penser à une population homogène qui pense et agit de la même manière à plusieurs siècles d’écart et plusieurs milliers de kilomètres d’écart, mais la réalité est plus complexe. Chez les Yamnayas de l’Ouest, il y a une claire prédominance masculine, mais pas autant que chez les Yamnayas de l’Est. On peut faire un parallèle avec les divinités des mythologies indo-européennes orientales qui sont encore plus masculines que celles occidentales.
Néanmoins, même dans les régions où les hommes sont sur-représentés dans les tombes, les femmes n’y sont pas totalement exclues. Les femmes sont présentes dans une tombe sur cinq et parfois même dans la tombe centrale d’un kourgane. Cela signifie peut-être que des rôles de pouvoir traditionnellement masculin pouvaient être occupés par une femme. La frontière entre les rôles masculins et féminins n’était peut-être pas aussi stricte et imperméable qu’on pourrait l’imaginer.
Mais cela ne veut pas dire que cette société n’était pas patriarcale, ne me faites pas dire ça ! Faisons une petite expérience de pensée et imaginons des historiens qui, dans 5000 ans, voudraient comprendre le fonctionnement de la société française en 2025. Pour comprendre qui composait la classe d’élites de notre société, ils pourraient par exemple étudier le genre des PDG ou DG des entreprises du CAC 40. Actuellement, il y a 4 femmes pour 36 hommes. Qu’est-ce que nos historiens du futur devraient conclure alors ? La France de 2025 n’est plus une société patriarcale car on constate une quantité non négligeable de femmes dans la classe dominante ? Ou : la France de 2025 est encore une société patriarcale car 90 % des postes de numéro 1 des plus grandes entreprises sont occupés par des hommes ? De mon côté, je ne vais pas conclure sur la France de 2025, mais il me semble que oui, l’archéologie confirme les études génétiques et linguistiques sur le fait que les sociétés de l’horizon Yamnaya étaient des sociétés patriarcales avec une prédominance masculine. La linguistique et la génétique semblent démontrer un ensemble de règles très strictes liant les hommes à l’héritage et au pouvoir. L’archéologie apporte cependant deux nuances cruciales pour une compréhension plus fine de ces sociétés. 1. La prédominance masculine dans les rôles méritant une reconnaissance particulière n’est pas visible partout dans l’horizon Yamnaya. 2. Si les hommes sont très largement représentés dans les positions de pouvoir chez les Yamnayas, cela n’empêche pas les femmes d’accéder à un rôle méritant une reconnaissance particulière.
Conclusion sur le patriarcat des Yamnayas
Peut-être qu’en écoutant l’organisation familiale des Yamnayas, vous vous êtes dit que finalement, ce n’était pas si différent de ce qui se passait dans les sociétés occidentales rurales jusqu’à assez récemment. Vous vous dites peut-être que toutes les sociétés ont fonctionnées comme ça. Alors pourquoi en faire tout un fromage ici, à part pour pouvoir mieux digérer du lait si on est intolérant au lactose ?
Le premier argument, c’est que, contrairement aux autres populations européennes de la même époque, nous avons pour les Proto-Indo-Européens des connaissances sur leur langage et donc, comme nous l’avons vu, sur l’organisation typique des familles.
Le second, c’est que globalement, on rentre depuis plusieurs épisodes dans le détail sur les Yamnayas, car ces individus sont les ancêtres principaux, culturellement et génétiquement, des Scandinaves. Et la culture occidentale dans son ensemble tire ses racines de ces Proto-Indo-Européens. En les comprenant dans quelque chose d’aussi intime que l’organisation de leur famille, on peut avoir des clés de compréhension sur les évolutions qui ont menées à la société scandinave de la période viking et à la société occidentale du Moyen-Âge, qui seront les théâtres de notre intrigue.
Le patriarcat était de mise chez les Yamnayas, mais ce n’était pas forcément le cas partout en Europe. Après avoir acquis la maîtrise de la steppe pontique, ces nomades vont se diffuser dans plusieurs directions. Celle qui nous intéresse est l’Europe. En chemin, ils vont rencontrer, interagir et globalement dominer les populations de ce que la célèbre archéologue lituanienne Marija Gimbutas appelait la Vieille Europe. Cette Vieille Europe, c’est l’ensemble des cultures néolithiques de l’Europe de l’Est. On compte notamment les fermiers de la culture Cucuteni-Trypillia, installés à la frontière de la steppe pontique depuis -5200, soit 2000 ans environ avant la diffusion des Yamnayas hors des steppes. Comme nous l’avons vu dans l’épisode 9, cette culture a sculpté des milliers de figurines féminines, les Vénus du néolithique, qui étaient probablement liées à un culte de la Déesse Mère. Marija Gimbutas théorise d’ailleurs que les sociétés fermières de la Vieille Europe étaient des sociétés matriarcales, ce qui contrastait drastiquement avec la société proto-indo-européenne qui s’est développée petit à petit à l’est de leur frontière…
Nous savons maintenant comment était organisé la famille chez les Yamnayas, cette famille qui représente le cœur de la société. Dans le prochain épisode qui clôturera cette immersion chez les Proto-Indo-Européens, nous découvrirons comment fonctionne la société dans son ensemble : sa hiérarchie, ses structure sociales, ses chefs et ses rois. Nous nous immergerons également dans les rituels indo-européens : des sacrifices d’animaux pour obtenir les faveurs des dieux aux rites initiatiques des jeunes guerriers. Enfin, nous découvrirons les mythes fondateurs des Proto-Indo-Européens, mythes qui ont traversé les âges et se retrouvent jusque dans la mythologie nordique telle que nous l’a racontée Odin dans l’épisode 3, que je vous conseille de réécouter d’ici là.
Si cet épisode vous a plu, n’hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préférée, c’est la meilleure façon d’être averti de la sortie des nouveaux épisodes. C’était Maxime Courtoison pour le podcast La Dent Bleue, l’histoire des vikings. Merci pour votre écoute et à bientôt !
Bibliographie complète
Sources principales :
- Anthony, D. W. (2007). The Horse, the wheel and language : How bronze-age riders from the eurasian steppes shaped the modern world. Princeton University Press.
- Beyin, A. (2011). Upper Pleistocene Human Dispersals out of Africa : A Review of the Current State of the Debate. International Journal of Evolutionary Biology, 2011(1), 615094.
- Burger, J. et al. (2020). Low Prevalence of Lactase Persistence in Bronze Age Europe Indicates Ongoing Strong Selection over the Last 3,000 Years. Current Biology, 30(21), 4307-4315.e13.
- Hanel, A., & Carlberg, C. (2020). Skin colour and vitamin D : An update. Experimental Dermatology, 29(9), 864‑875.
- Olsen, B. A., Olander, T., & Kristiansen, K. (2019). Tracing the Indo-Europeans : New evidence from archaeology and historical linguistics. Oxbow Books.
- Sjögren, K.-G. et al. (2020). Kinship and social organization in Copper Age Europe. A cross-disciplinary analysis of archaeology, DNA, isotopes, and anthropology from two Bell Beaker cemeteries. PLOS ONE, 15(11), e0241278.
Sources secondaires :
- Allentoft, M. E. et al. (2015). Population genomics of Bronze Age Eurasia. Nature, 522(7555), Article 7555. https://doi.org/10/f3npvw
- Courtoison, M. (2024). 2 – À la conquête du Grand Nord ! La Dent Bleue, l’histoire des vikings (retrouvez sur l’article les sources originelles en ce qui concerne le peuplement de l’Europe au paléolithique supérieur)
- Courtoison, M. (2024). 5 – Une invasion de fermiers en Europe ? La Dent Bleue, l’histoire des vikings (retrouvez sur l’article les sources originelles en ce qui concerne la néolithisation de l’Europe)
- Dor, C. et al. (2022). Milk and dairy consumption is positively associated with height in adolescents : Results from the Israeli National Youth Health and Nutrition Survey. European Journal of Nutrition, 61(1), 429‑438.
- Fu, Q. et al. (2016). The genetic history of Ice Age Europe. Nature, 534(7606), 200‑205.
- Garnier, R., Sagart, L., & Sagot, B. (2017). Milk and the Indo-Europeans. In M. Robbeets & A. Savelyev (Éds.), Language Dispersal Beyond Farming (p. 291‑311). John Benjamins Publishing Company.
- Mathieson, I. et al. (2015). Genome-wide patterns of selection in 230 ancient Eurasians. Nature, 528(7583), 499‑503.
- Stock, J. T. et al. (2023). Long-term trends in human body size track regional variation in subsistence transitions and growth acceleration linked to dairying. Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(4), e2209482119.
- Trautmann, M. et al. (2023). First bioanthropological evidence for Yamnaya horsemanship. Science Advances, 9(9), eade2451.
Crédits
Musique de générique : « Heavy Interlude » de Kevin MacLeod. ( http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100515 ). Licence Creative Commons Attribution 4.0.
Courtes citations :
- Village People – Macho Man – 1978 : https://www.youtube.com/watch?v=AO43p2Wqc08
- Le Dîner de cons, Francis Veber, 1998 : https://www.youtube.com/watch?v=au0ZMqyoWwg
- Gims, OuiHustle : https://www.youtube.com/shorts/e4xpD3HKxpQ
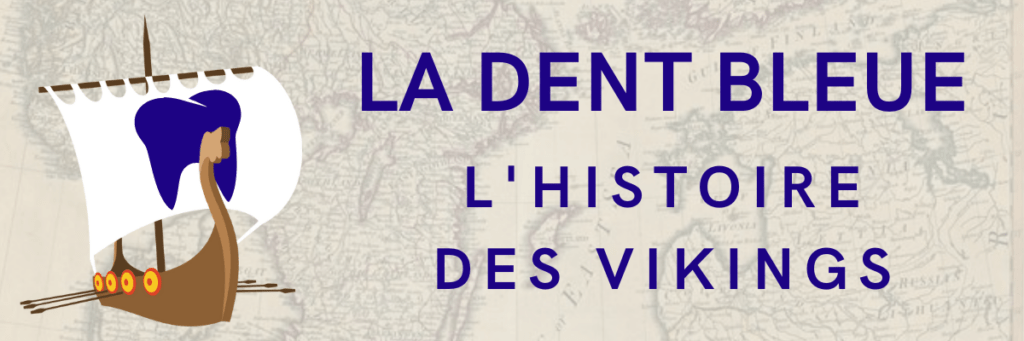
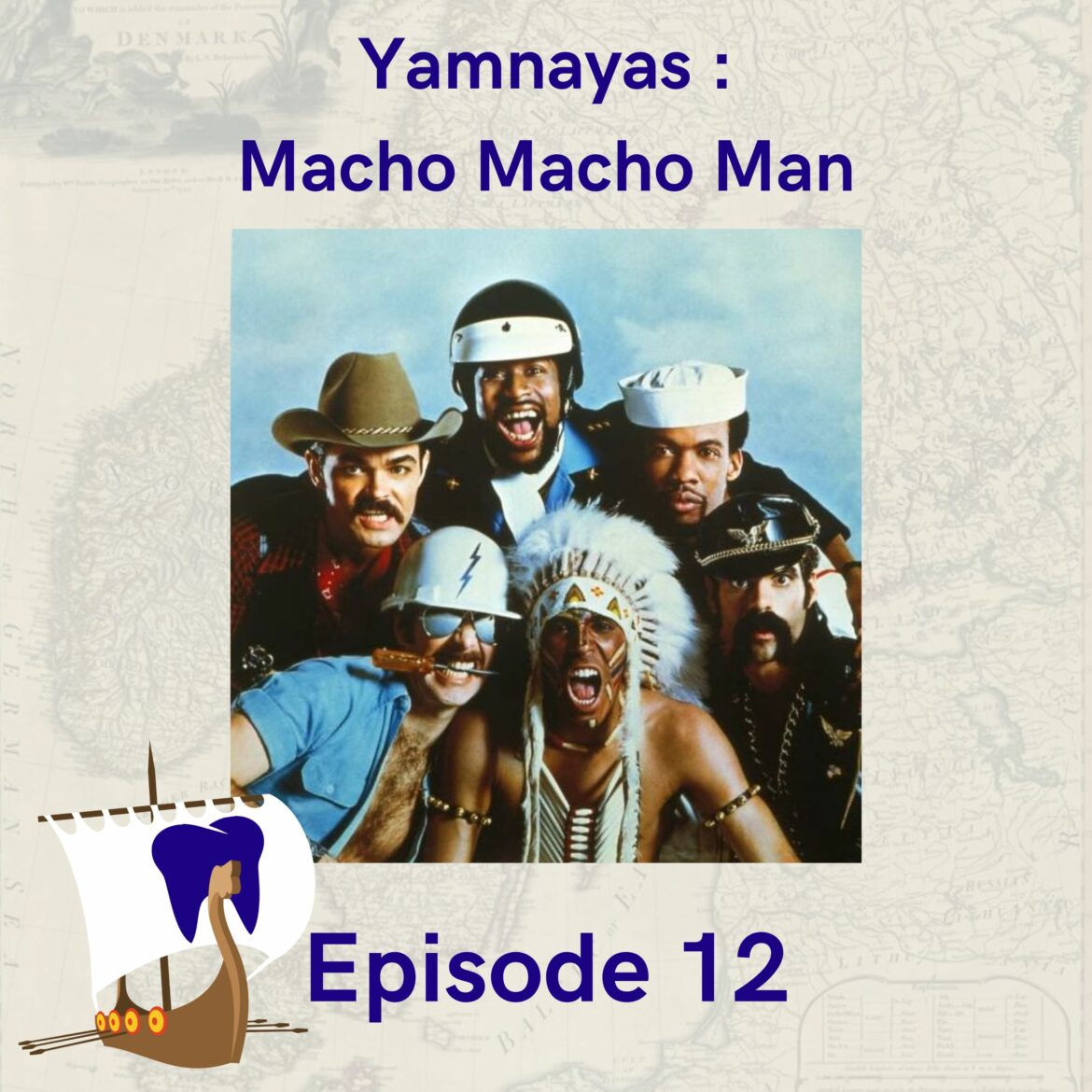
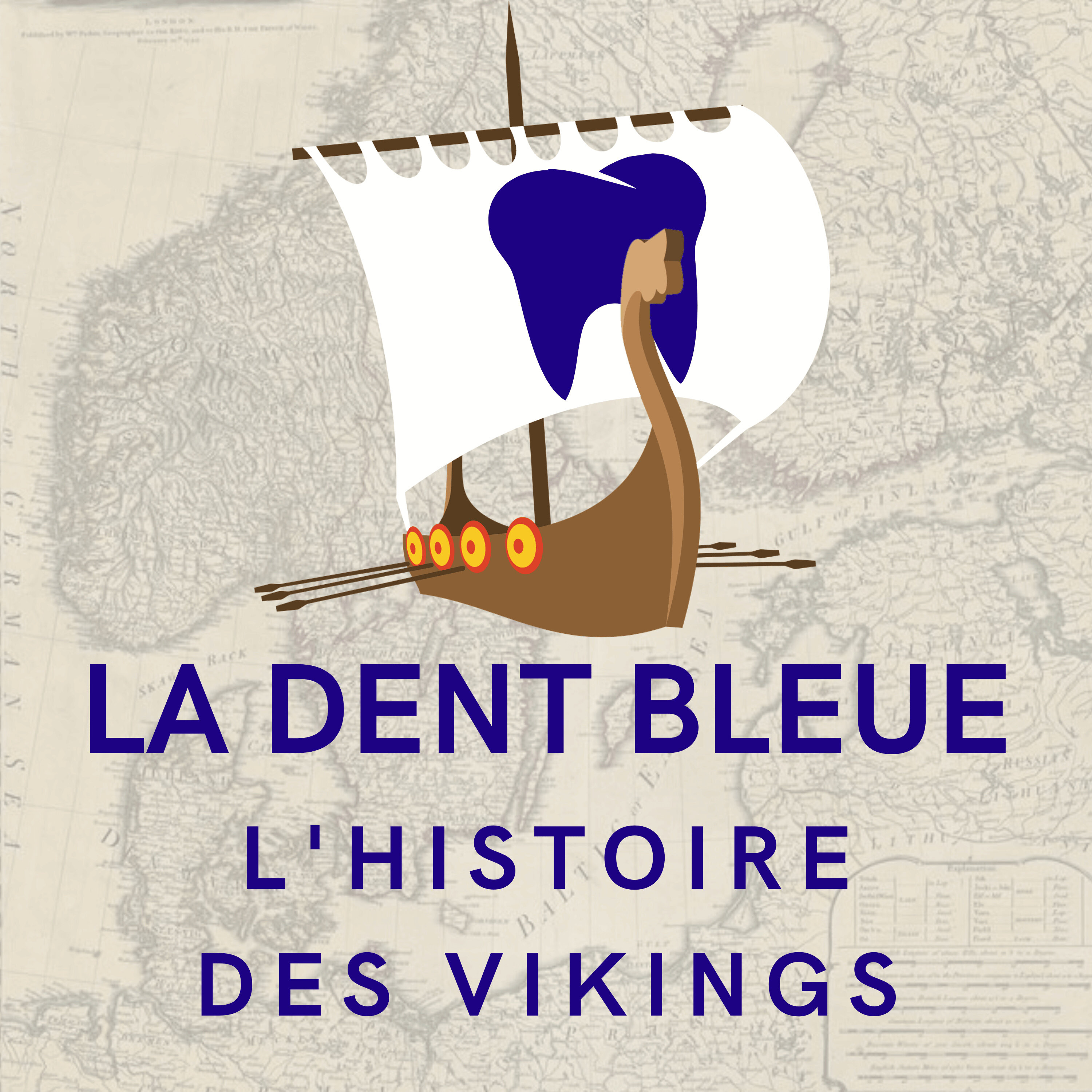
Laisser un commentaire